L’art est depuis longtemps lié à la guerre. Au lieu de prendre les armes, les artistes saisissent leurs pinceaux, leurs outils de sculpture ou leur appareil photo et entrent dans la mêlée pour documenter, faire de la propagande, critiquer ou commémorer les batailles qui façonnent l’histoire. Au Canada, très peu d’œuvres d’art de guerre autochtone pré-contact ont survécu, mais le savoir-faire transmis a perduré dans l’art et les traditions créatives autochtones post-contact, en parallèle aux œuvres d’art et aux objets fabriqués par les colons. Puis, les programmes officiels d’art de guerre canadiens, lancés pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, ont contribué à forger une nouvelle identité nationale. Aujourd’hui, l’art de protestation et les autres œuvres créées en réponse aux conflits contemporains jouent un rôle de premier plan.
L’ère de l’expansion européenne

Peu de preuves visuelles de l’activité militaire au Canada avant 1600 subsistent encore aujourd’hui, mais des armes anciennes datant de milliers d’années, trouvées dans des sites funéraires de la côte du Nord-Ouest, fournissent tout de même quelques indices. Elles suggèrent entre autres que les cérémonies associées aux cultures guerrières étaient porteuses de créativité. Depuis les premiers contacts avec les Européens, on constate un nombre croissant d’armes, d’armures et de vêtements qui rappellent les riches traditions des premières cultures visuelles autochtones. Cependant, nos meilleures sources pour les exploits militaires antérieurs demeurent les histoires orales racontées par les aîné·es et les conteurs et conteuses des nations autochtones du Canada de même que les reprises d’anciennes pratiques après l’arrivée des Européens.
La plupart des artefacts évoquant l’art de guerre précolonial, mais dont la fabrication date d’une plus récente époque, représentent des objets utiles réalisés à la main, avec une attention soutenue accordée à la conception et un sens aigu de la beauté. Contrairement à une grande partie de l’art militaire occidental, imprégné de classicisme et chargé de messages, mais inutile en termes pratiques, le premier art de guerre autochtone est aussi fonctionnel que beau et rituel. La pipe de cérémonie, plus précisément le calumet de la paix, constitue un témoignage visuel des conflits autochtones menés au Canada en des temps lointains. Fumer le calumet cimentait les alliances militaires, les traités de paix et d’autres obligations contractuelles. Son utilisation toujours actuelle nous permet de mesurer la portée symbolique de l’objet. Traditionnellement, la pipe est formée d’une longue tige ornée de peinture, de fourrure, de piquants de porc-épic et de plumes. Le fourneau est généralement sculpté dans la pierre. Le calumet tortue du début du dix-septième siècle, conservé au Musée royal de l’Ontario, renvoie possiblement au nom par lequel les Premiers Peuples désignent l’Amérique du Nord : l’île de la Tortue.
Entre le seizième et le dix-huitième siècle – ou plus tôt si l’on inclut les expéditions vikings – des explorateurs et des commerçants de nombreux pays européens cherchent à prendre pied sur l’île de la Tortue. Dès le début, les peuples autochtones, que les Scandinaves nommaient Skrælings, défendent leur territoire. La Carte de Skálholt, créée en 1570, dont seule subsiste une copie réalisée en 1690, montre comment les habitants du « Skralinge Land » (en bas à gauche) ont forcé les Vikings à retourner au Groenland (en haut à gauche) vers 1015 de notre ère. Mais ce succès précoce n’assurera pas à long terme la sécurité des Premiers Peuples. Équipés de fusils et d’autres armes perfectionnées, les Européens n’hésiteront guère à les utiliser dans leur intérêt et contre les Autochtones. La colonisation implique intrinsèquement un conflit auquel prennent part toutes les parties concernées.


Entre 1534 et 1542, l’explorateur français Jacques Cartier fait trois voyages dans le golfe du Saint-Laurent à la recherche du légendaire passage du Nord-Ouest vers l’Asie. Il revendique ce nouveau territoire pour la France, cartographie le grand fleuve qu’il découvre jusqu’à Montréal et décrit les peuples autochtones qui vivent sur ses rives. Puis, il rentre chez lui, sans fonder de colonie permanente. Les cartes et les graphiques illustrés deviendront les principaux documents de ses voyages.
L’Atlas Vallard, 1547, forme peut-être la plus célèbre collection de cartes anciennes comprenant la côte est de l’Amérique du Nord. Remarquable produit de la célèbre école cartographique de Dieppe, en France, l’atlas rationalise visuellement les avantages de la conquête dans sa représentation singulière de l’est du Canada. Les figures armées qui parsèment la carte en question transforment son imagerie minutieuse en art de guerre. Les rôles relatifs des colonisateurs et des colonisés y sont clairement définis : on représente les peuples autochtones comme de véritables guerriers, alors que les armes portées par les Européens paraissent seulement protéger ces derniers.
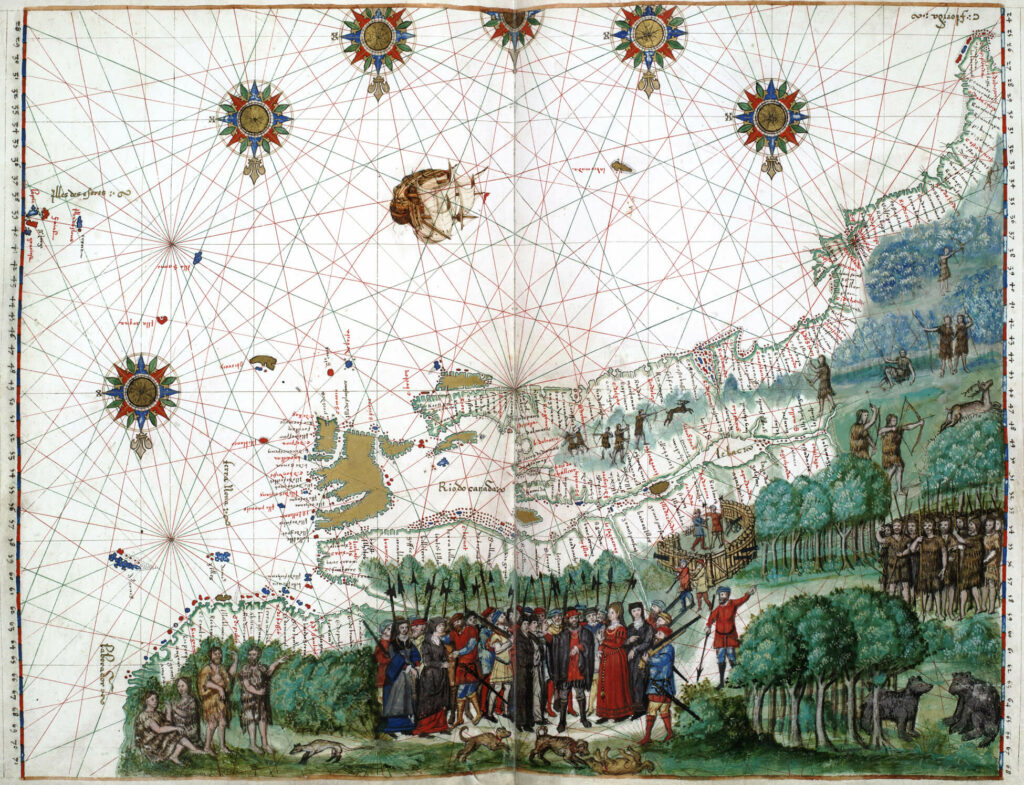

À l’instar des Français, confiants dans leur supériorité militaire sur l’opposition locale, les Britanniques envoient, entre 1576 et 1578, Martin Frobisher, marin et navigateur de talent, avec des navires et des hommes pour explorer un éventuel passage vers les richesses de l’Asie. Lors du second voyage, John White (actif de 1577 à 1593) documente à l’aquarelle The Skirmish at Bloody Point, Frobisher Bay (Escarmouche à Bloody Point, Frobisher Bay), 1585-1593, une rencontre entre un groupe de chasseurs inuits et des marins britanniques qui conduit plusieurs Inuits à la mort tandis qu’un seul blessé afflige le camp anglais.

En 1608, le Français Samuel de Champlain établit la première colonie française à Québec. Opposé à la confrontation, il rêve d’établir en Amérique du Nord une nouvelle nation fondée sur la coopération et les mariages mixtes entre les peuples autochtones et les colons européens. Sa carte de 1612, méticuleusement dessinée et reproduite pour le marché français de l’imprimerie en l’espace d’un an, comporte non seulement des détails géographiques tels que des collines, des rivières et des côtes, mais également des dessins d’animaux, de plantes et de fruits qu’il a observés ainsi que des portraits en pied d’un certain nombre d’habitants autochtones.
Pourtant, bien qu’il ait eu des intentions sans doute pacifiques pour assurer l’établissement des Français à Québec, Champlain s’allie aux peuples Wendat (Hurons), Anichinabé (Algonquins), Innu (Montagnais) et Etchemin vivant le long des rives du fleuve Saint-Laurent, en guerre contre les Haudenosaunee (Iroquois) établis plus au sud. Comme l’indique un dessin publié en 1613, le groupe de Champlain, qui explorait la région de l’actuel lac Champlain en 1609, tombe sur un groupe combatif d’Haudenosaunee et une bataille s’ensuit. Champlain tire son arquebuse et tue deux membres du groupe d’un seul coup : certes, le geste met fin à la bataille, mais les Français s’attirent également un ennemi permanent.
L’intensification des conflits conduit les Autochtones à conclure des traités avec les colons pour renforcer leur position. Outre la cérémonie du calumet, les peuples autochtones des Grands Lacs à l’Île-du-Prince-Édouard utilisent, à des fins ornementales, cérémonielles, diplomatiques et commerciales (pour enregistrer, entre autres, les traités de paix et autres alliances), une ceinture de coquillages violets et blancs magnifiquement tissée, connue sous le nom de ceinture wampum. Le Teioháte Kaswenta (ceinture wampum à deux rangs), 1613, a été créé lors du premier traité de paix conclu dans le nord de l’État de New York entre le peuple Haudenosaunee et le gouvernement néerlandais. Même si l’original n’existe plus, la tradition orale et les documents écrits ultérieurs tentent toujours de faire respecter certaines des dispositions réglementaires traduites visuellement par les lignes régulières des coquillages violets et blancs, qui n’interfèrent pas les unes avec les autres.

La suite de l’histoire montre toutefois que les puissances coloniales ne respecteront généralement pas ces pactes sacrés. La plupart des nouveaux arrivants ayant suivi Champlain en Nouvelle-France sont motivés par des idées de conquête, d’avancement économique et social, et d’évangélisation. Les conflits deviennent alors un mode de vie au Canada pour les premiers habitants et les nouveaux colons, lesquels s’efforcent de garder le contrôle des terres et des ressources. En effet, les Haudenosaunee resteront longtemps des adversaires redoutables, comme en témoigne le Portrait d’un illustre borgne, s.d., une petite composition figurant un guerrier identifié et lourdement décoré, réalisée par le missionnaire jésuite français Louis Nicolas (1634-après 1700).
Un artefact unique nous renseigne sur un affrontement violent entre les Autochtones de l’époque. En 1904, Mesaquab (Jonathan Yorke), un Ojibway du lac Simcoe, en Ontario, utilise des piquants de porc-épic et du foin d’odeur pour reproduire de mémoire, sur le couvercle d’une boîte en écorce de bouleau, une scène de bataille peinte à l’origine sur un rocher à Quarry Point, au lac Couchiching, en Ontario, quelque deux cents ans plus tôt. L’idée de cette création est probablement venue le jour où le rocher s’est effondré dans l’eau. Bordé de deux arbres, le dessin linéaire relativement simple représente deux guerriers ojibways, l’un armé d’un gourdin, l’autre d’un fusil. Au sol, un petit homme Kanienʼkehá:ka (Mohawk), un arc et des flèches à la main, attend la mort ou se rend.


La Grande-Bretagne et la France luttent pour le contrôle du territoire
Au milieu des années 1700, la France, la Grande-Bretagne et leurs alliés autochtones combattent pour le contrôle de l’Amérique du Nord. La France voit en sa colonie de Nouvelle-France à la fois un puits de ressources naturelles, notamment de fourrures, un marché profitable pour les produits fabriqués en France et un lieu permanent d’une société chrétienne bien gouvernée en Amérique du Nord. Aussi des peintures et de petites sculptures importées de France sont-elles utilisées dans les églises et dans les institutions civiques et religieuses. Certains artistes itinérants viennent également d’Europe, et l’art du portrait atteint un haut degré de sophistication. Citons, à titre d’exemple, le portrait anonyme du Marquis de Boishébert, v.1753, représentant l’officier né à Québec qui a dirigé la résistance à l’expulsion britannique des Acadiens français du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard en 1755.

Contrairement à la relative rareté de l’art de guerre en Nouvelle-France, l’art militaire britannique prolifère. Après l’ouverture de la Royal Military Academy de Woolwich, en Angleterre, en 1741, on envoie les élèves-officiers diplômés, spécialement formés aux techniques du dessin et de l’aquarelle, pour rendre compte des infrastructures armées et des escarmouches dans les colonies britanniques d’Amérique du Nord. Pour qu’il soit utile aux autorités militaires, le travail de ces artistes devait être correct et précis, ce qui n’empêchait pas pour autant sa commercialisation auprès d’un public friand de succès britanniques. Les dessins et les aquarelles de Hervey Smythe (1734-1811) et de Richard Short (actif v.1754-1766), notamment, sont transposés en gravures pour faire connaître l’expansion britannique. En 1761, les esquisses de Short ont servi de base à une série d’estampes illustrant la conquête de la ville de Québec par les Britanniques deux ans plus tôt, et montrant la dévastation avec force détails, alors que soldats et citoyens contemplent les conséquences de la bataille. Charles Ince (actif v.1750), lui, assiste à la destruction totale de Louisbourg en 1758 qu’il dessine au début du siège. Son dessin devient ensuite une gravure largement diffusée. Et enfin, Thomas Davies (1737-1812), officier de l’artillerie royale britannique, peint A View of Fort La Galette, Indian Castle, and Taking a French Ship of War on the River St. Lawrence, by Four Boats of One Gun Each of the Royal Artillery Commanded by Captain Streachy (Vue du fort La Galette, poste indien, et de la prise d’un vaisseau de guerre français sur le Saint-Laurent, par quatre bateaux d’un canon chacun, sous les ordres du capitaine Streachy de la Royal Artillery), 1760, une œuvre qui, comme le titre l’indique, révèle une grande quantité d’informations documentaires – non seulement sur le fort, mais aussi sur la bataille fluviale et sur les vêtements portés par deux observateurs autochtones.
Des artistes célèbres en Grande-Bretagne représentent également des événements se déroulant au Canada. Ils créent des peintures pour le public britannique et, lorsque ces dernières font l’objet d’expositions publiques, de reproductions et de diffusion sous forme de gravures, elles informent la population des succès militaires de leur pays et nourrissent le sentiment d’identité nationale. The Death of General Wolfe (La mort du général Wolfe), 1770, de Benjamin West (1738-1820), une représentation romantique et imaginée à partir des faits des derniers moments du commandant britannique constitue l’une des œuvres les plus connues du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC). Wolfe et ses troupes avaient affronté les forces françaises du marquis de Montcalm lors de la bataille des plaines d’Abraham, à Québec, en 1759, à l’issue de laquelle le conflit entre les deux pays bascule en faveur de la Grande-Bretagne. Cet événement marque un tournant majeur dans la rivalité entre les deux puissances, lesquelles se disputaient depuis deux siècles le contrôle de l’Amérique du Nord. Le conflit s’éteint à la fin de la guerre de Sept Ans, avec la signature du traité de Paris en 1763 – la France cède ses colonies « canadiennes » à la Grande-Bretagne : c’est alors la fin de la Nouvelle-France et le début d’un nouveau régime, soit l’Amérique du Nord britannique.

Un État de garnison
Après la guerre d’Indépendance américaine de 1775-1783 (et la perte par la Grande-Bretagne du territoire qui correspond aujourd’hui aux États-Unis), le Canada devient un État de garnison, où l’armée britannique se fait très présente. On peint les chefs militaires, y compris les chefs autochtones, pour appuyer, comme toujours, le sens de la coopération mutuelle plutôt que celui du conflit. Un portrait célèbre, vraisemblablement posthume, Thayendanegea (Joseph Brant), v.1807, réalisé par le Canadien d’origine allemande William Berczy (1744-1813), montre le chef Kanienʼkehá:ka dans une pose classique, revêtant une tenue qui présente des attributs autochtones. Originaires de terres situées dans ce qui est aujourd’hui l’État de New York, Thayendanegea et ses disciples se sont établis au Canada après la guerre d’Indépendance américaine pendant laquelle ils avaient combattu pour les Britanniques.


De même, l’artiste irlandais Solomon Williams (1757-1824) peint Major John Norton (Teyoninhokarawen), v.1804, un portrait du chef de guerre Kanienʼkehá:ka (et neveu adoptif de Thayendanegea) ayant dirigé, aux côtés des Britanniques, les forces autochtones contre les Américains lors de la bataille de Queenston Heights, pendant la guerre de 1812, 1812-1815. La combinaison de vêtements haudenosaunees et britanniques de Teyoninhokarawen reflète son double héritage et les échanges culturels permanents entre les peuples autochtones et les Européens.


Au début du dix-neuvième siècle, les œuvres d’art créées par les artistes militaires britanniques au Canada soutiennent l’idée d’une période marquée par une harmonie non conflictuelle. Un monument important de John Crawford Young (1788-v.1859) à Québec, le Monument Wolfe et Montcalm, 1827, de conception classique, réunit les ennemis en un seul mémorial et promeut donc activement le principe d’unité dans une colonie plutôt divisée. De même, l’apparence détendue de l’homme, du garçon et du chien qui se promènent tranquillement le long d’un sentier boisé dans Road Between Kingston and York, Upper Canada (Chemin entre Kingston et York, Haut-Canada), v.1830, de James Pattison Cockburn (1778-1847), semble nier l’importance de la route pour le transport militaire, une route pourtant coupée et nivelée par le travail harassant des soldats. L’armée britannique a joué un rôle essentiel dans la répression des rébellions de 1837, alors que les colons du Bas et du Haut-Canada ont pris les armes et se sont soulevés dans l’espoir d’obtenir un plus grand contrôle du gouvernement. Ces événements figurent peu dans les œuvres, bien que la bataille de Saint-Eustache, un conflit de la rébellion du Bas-Canada, ait été représentée dans une estampe parue en 1840.
En 1829, Shanawdithit réalise une série de dessins témoignant de l’histoire tragique de sa tante Demasduit : il en résulte de puissantes images qui mettent en évidence les conséquences pernicieuses de la colonisation à cette époque. Demasduit était une femme Béothuk, l’un des derniers peuples autochtones qui occupaient traditionnellement Terre-Neuve. Sous forme de pictogrammes, Shanawdithit raconte les répercussions d’un acte jugé illégal par les Occidentaux. En 1818, un groupe de Béothuks vole un bateau et du matériel de pêche. Huit colons armés sont alors envoyés pour les récupérer. Ils parviennent à capturer Demasduit lors de l’escarmouche qui s’ensuit et tuent son mari, un chef, pendant que ce dernier tente d’empêcher la capture de son épouse. Leur nourrisson décède quelques jours plus tard. Demasduit elle-même s’éteint en 1820, un an à peine après sa capture. En 1823, des pelletiers européens trouvent Shanawdithit, sa mère et sa sœur affamées et les amènent à St. John’s. Les membres de sa famille meurent peu après de la tuberculose, et Shanawdithit entre en service. En 1829, elle décède à son tour; elle était la dernière des Béothuks.
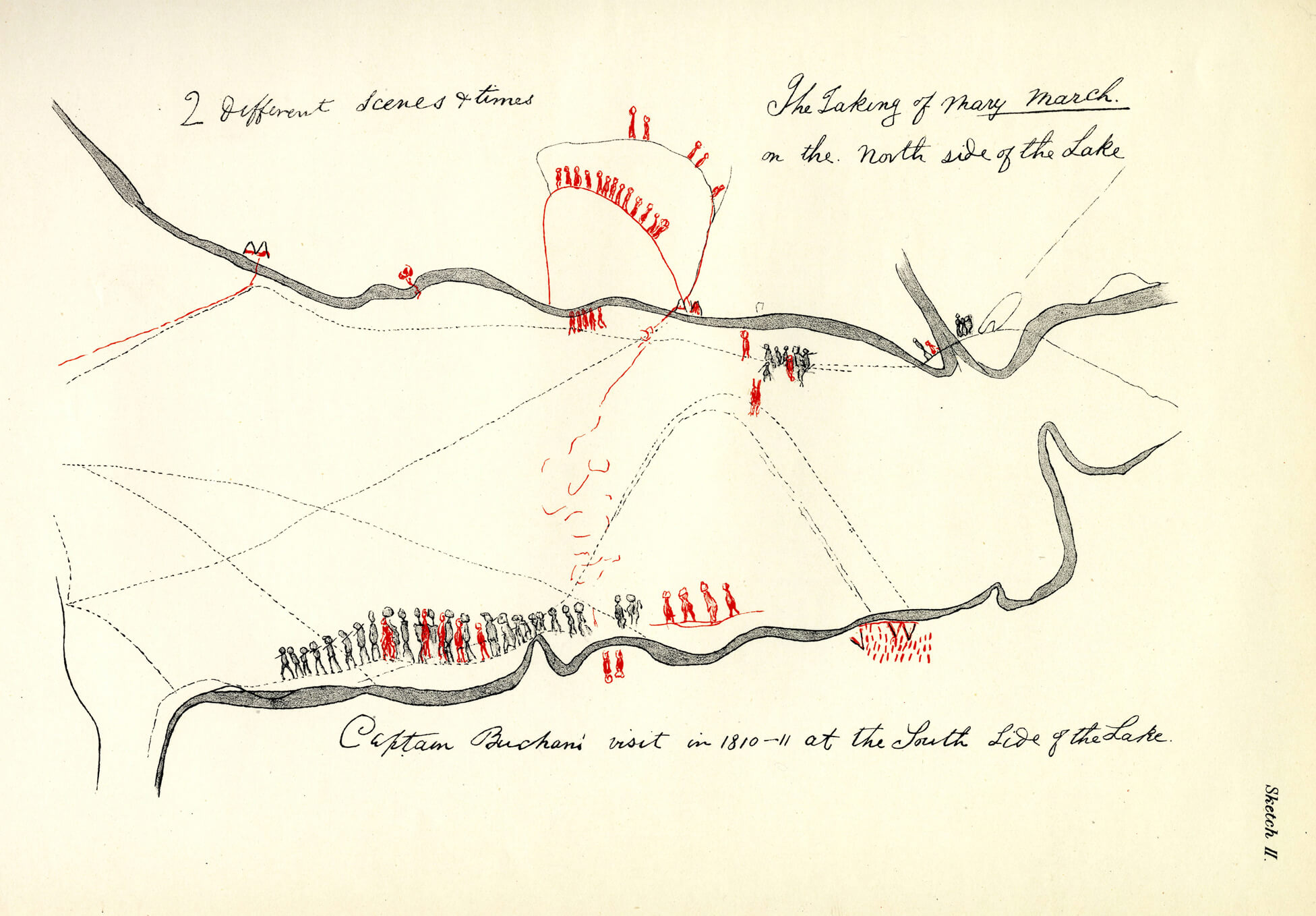
En Europe, l’intérêt croissant pour les conflits autochtones encourage les artistes occidentaux à représenter des scènes de combat destinées à un public colonial, renforçant ainsi les stéréotypes trompeurs et violents sur les guerriers des Prairies. Entre 1849 et 1856, par exemple, dans The Death of Omoxesisixany [Big Snake] (La mort d’Omoxesisixany [Grand Serpent]), l’artiste canadien d’origine irlandaise Paul Kane (1810-1871) peint la mort dramatique d’un chef Piikani à cheval, assassiné par un guerrier cri. Kane avait voyagé à travers le Canada; il avait eu vent de l’événement et avait alors voulu le reconstituer au moyen de son imagination, en s’inspirant des peintures de duels équestres européens dont il connaissait quelques reproductions. Également collectionneur, Kane a agrémenté sa composition d’un sac à bandoulière de guerrier cri qu’il avait en sa possession. Théâtrale, intense et visuellement fascinante, La mort d’Omoxesisixany [Grand Serpent] constitue la seule peinture de Kane produite en série et commercialisée en son temps. L’image reflétait moins la réalité qu’elle ne répondait aux attentes du public avide de découvrir le « Far West ».

Sur la côte du Nord-Ouest, les traditions d’art de guerre des Premiers Peuples du Canada remontent à des millénaires. Les guerriers haïdas portaient des armures, notamment des casques, des visières et des plastrons. Certaines de ces protections sont magnifiquement décorées, comme le casque de guerre en forme de tête de phoque en bois avec des dents et des yeux en cuivre, que l’on trouve aujourd’hui au Musée canadien de l’histoire. Jusqu’à ce que les colons introduisent les armes à feu chez les Haïdas, les gourdins comptaient parmi leurs armes préférées. Citons ici l’objet – vraisemblablement cérémoniel – datant d’avant 1778 et provenant de la baie de Nootka qui présente une redoutable tête de saumon en bois sculpté aux yeux éblouissants, une massue en pierre formant sa grande langue saillante. On lui a en outre ajouté des cheveux humains et des dents de loutre de mer, qui l’embellissent prodigieusement. Elle aurait peut-être appartenu à un chef héréditaire et symbolise, par son identification avec le saumon, son pouvoir dans et sur le monde vivant présent et futur.


À mesure que le Canada se développe à partir des côtes vers son centre géographique, les colonisateurs découvrent des pièces d’art des guerriers des Plaines et recueillent ainsi des informations sur ces habitants et sur leurs batailles. Aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, les guerriers nomades des Prairies inscrivaient les récits de leurs victoires sur des peaux de bison et de cerf. Ces guerriers se vêtaient de peaux pour prouver leur statut au sein de la communauté et raconter leurs actes de bravoure, comme l’illustrent les pictogrammes expressifs, dessinés dans des formes stylisées aux tons terreux sur une peau d’animal. Une splendide peau (probablement d’origine Niitsitapi [Pieds-Noirs]) conservée au Musée royal de l’Ontario dépeint, avec force détails, vingt et une histoires martiales distinctes, dont la capture d’armes et la blessure ou la mort de nombreux ennemis. Des entailles et des coupures parsèment les habits des guerriers des Plaines, en particulier les chemises des hommes : ces marques représentent des blessures de flèches et de lances. Les dessins apparaissent également sur les parois rocheuses et attestent des batailles remportées – pensons notamment à la scène de combat de 250 pétroglyphes à Áísínai’pi (Writing-on-Stone Park) en Alberta, datant de la fin des années 1800.
L’ère de la Confédération
Au lendemain de la Confédération, en 1867, un événement unissant l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick en un nouveau dominion au sein de l’Empire britannique, le Canada se voit encore une fois marqué par la violence, désormais documentée par la photographie, une nouvelle technologie inventée en France, en 1839. Les invasions des fenians, de 1866 à 1871, constituent les premières escarmouches photographiées dans la nouvelle nation canadienne. Les fenians, des immigrants irlandais établis aux États-Unis, croient que si leur prise du Canada réussit, elle saura persuader le gouvernement britannique d’échanger le dominion contre l’indépendance de l’Irlande. La multiplicité des tentes du gouvernement et de l’attirail militaire dans The Pigeon Hill [Eccles Hill] Camp of the 60th Battalion (Le camp du 60e Bataillon de Pigeon Hill [Eccles Hill]),1870, du peintre et photographe canadien William Sawyer (1820-1889), montre le sérieux de la riposte canadienne à la menace des fenians.

La rébellion du Nord-Ouest de 1885 (aujourd’hui connue sous le nom de résistance du Nord-Ouest), qui se déroule dans les territoires de l’actuelle Saskatchewan et Alberta, entraîne la mort de centaines de troupes gouvernementales, de militants métis et de guerriers des Premières Nations. Les colons occidentaux nouvellement arrivés craignent les Premières Nations et les Métis déjà établis dans la région, alors que les groupes autochtones refusent de s’assujettir encore davantage aux Britanniques et de céder leurs terres. Inspirés par le chef métis Louis Riel, les peuples autochtones mettent en place un gouvernement provisoire, que l’action militaire canadienne rend rapidement impuissant. Riel finira pendu, mais il demeurera un symbole de la discorde linguistique, raciale et religieuse au Canada.
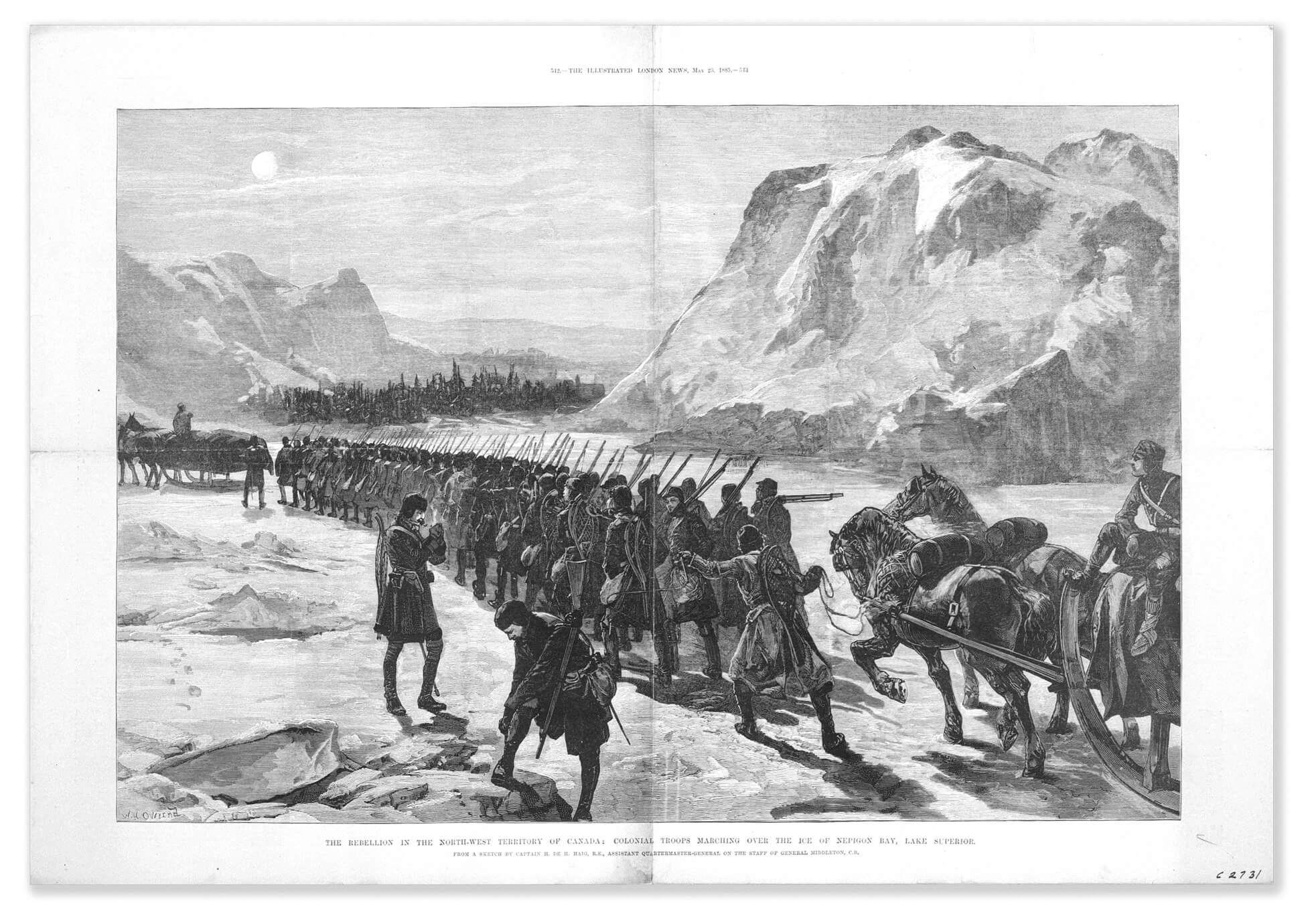
De nombreux monuments commémorent le conflit, certains honorant la milice coloniale, d’autres ses opposants métis et autochtones. “Sewing Up the Dead”: Preparation of North-West Field Force Casualties for Burial (« Recoudre les morts » : préparation des victimes de la Force de campagne du Nord-Ouest pour l’enterrement), 1885, une image du soldat et photographe canadien James Peters (1853-1927), révèle les conséquences brutales sur les deux camps. Le procès de Riel est lui aussi documenté par la photographie – citons, à titre d’exemple, Louis Riel Addressing the Jury during His Trial for Treason (Louis Riel s’adressant au jury pendant son procès pour trahison), 1885, du photographe américain Oliver Buell (1844-1910).
Les artistes graphiques à l’emploi des hebdomadaires britanniques s’intéressent également aux aspects militaires de la résistance à l’aide d’une technique de reproduction de pointe, comme en témoigne l’illustration de troupes coloniales frileuses en marche, The Rebellion in the North-West Territory of Canada: Colonial Troops Marching over the Ice of Nepigon Bay, Lake Superior (La rébellion dans le territoire du Nord-Ouest du Canada : troupes coloniales marchant sur la glace de la baie de Nepigon, lac Supérieur), 1885, du soldat-artiste britannique Herbert de Haga Haig (1855-1945). Le Graphic et l’Illustrated London News retouchaient souvent les dessins originaux pour en augmenter l’impact visuel, alors que le Sphere publiaient des croquis non modifiés. Malheureusement, les quelques magazines canadiens actifs à cette époque étaient éphémères et leur rayonnement ne dépassait guère le cadre régional.
Dans les années suivant la rébellion de 1885, le Canada renforce son pouvoir sur les peuples autochtones des Plaines, les forçant à vivre dans des réserves, établissant le système des pensionnats et collectionnant de plus en plus d’objets d’art autochtones. Les premières photographies offrent des images révélatrices des guerriers des Plaines et de leurs insignes, tels que les bâtons à coups. On associe ces objets – des perches dentelées ornées de plumes, de fourrure, de cuir, de peinture, de perles et d’autres éléments décoratifs – au « comptage des coups », un système de notation adopté au moment des premiers contacts avec les Européens par de nombreuses tribus des Plaines pour suivre de près les faits d’armes. Pour qu’un coup compte, il doit avoir été observé par d’autres guerriers et officiellement reconnu par un conseil tribal. Le photographe, artiste et ethnologue canadien Edmund Morris (1871-1913) décrit la dimension documentaire et cérémonielle de la culture guerrière historique, l’artisanat des artefacts ainsi que leur grande beauté, notamment dans son image de 1907 du chef Piikani Stamiik’siisapop (Bull Plume) portant son bâton à coups dentelé et garni de plumes aux côtés de Minnikonotsi (Homme en colère à cause de la faim).

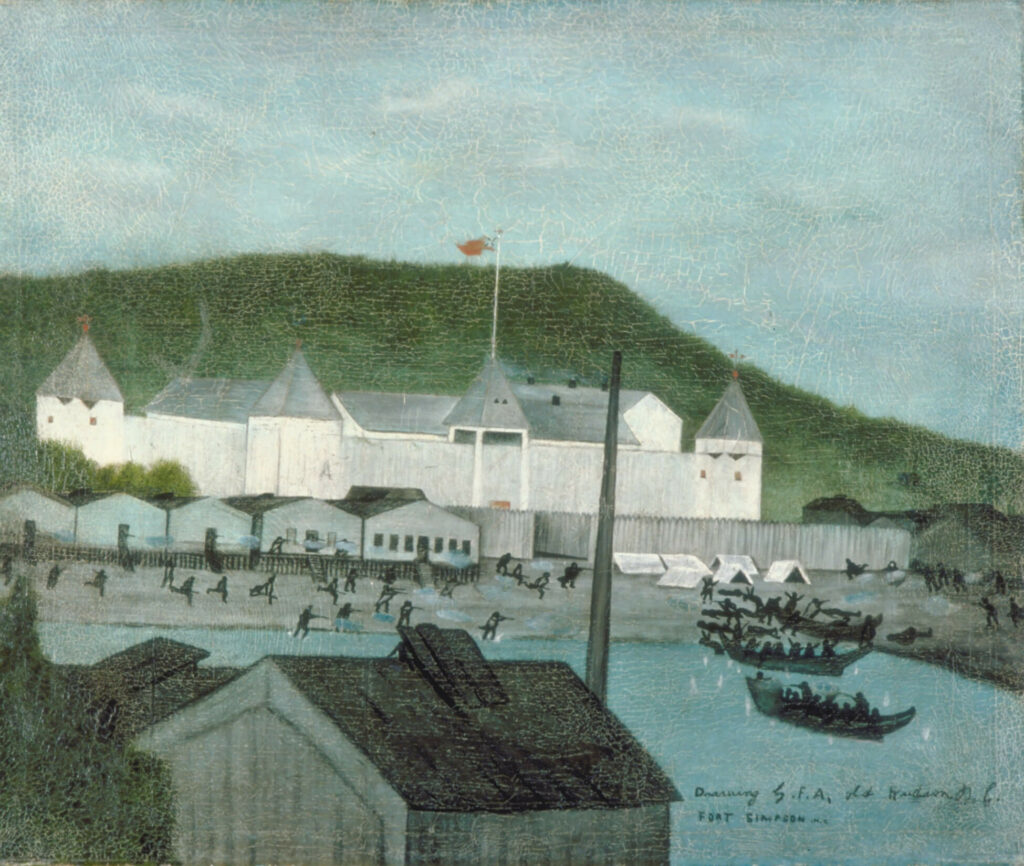
L’établissement de l’autorité britannique au Canada et l’expansion des réserves et des pensionnats coïncident avec l’émergence de deux phénomènes, soit l’augmentation de la colonisation européenne et un intérêt naissant tant pour les histoires que les artefacts associés aux peuples autochtones du Canada. Au fil du temps, certains artistes autochtones adoptent des manières européennes dans le but de raconter leurs récits de guerre. Les peintures de Frederick Alexcee (v.1857-v.1944), par exemple, révèlent à la fois sa connaissance de l’histoire de la côte du Nord-Ouest, telle que racontée par les conteurs, et sa compréhension des formes d’art européennes. Fils d’une femme Tsimshian et d’un homme Haudenosaunee, il peint A Fight Between the Haida and Tsimshian (Un combat entre les Haïdas et les Tsimshians), v.1896. L’image représente une bataille autochtone qui s’est déroulée en 1855 à Port Simpson, le site du poste de Fort Simpson de la Compagnie de la Baie d’Hudson, sur la côte centre-nord de la Colombie-Britannique. Soulignant peut-être les inégalités de pouvoir caractéristiques de l’époque, le fort domine de façon spectaculaire les guerriers tsimshians et haïdas et leurs quelques canots. Les armes à feu, omniprésentes dans l’image, traduisent l’impact de la colonisation européenne au Canada, laquelle a imposé bien plus que ses styles de peinture.
Au fur et à mesure que le pays s’agrandit, on construit d’autres monuments pour nourrir le sentiment d’appartenance à la nation. À Brantford, en Ontario, les pères de la ville érigent en 1886 le Monument à la mémoire de Joseph Brant, de conception britannique, en hommage à Thayendanegea, le chef Kanienʼkehá:ka ayant combattu aux côtés des Britanniques pendant la guerre d’Indépendance américaine. Peu à peu, des Canadiens deviennent sculpteurs ou s’investissent dans la construction des monuments. Le curieux Portrait Bust of Techkumthai [Tecumseh] (Portrait en buste de Techkumthai [Tecumseh]), 1896, de Hamilton MacCarthy (1846-1939), créé en la mémoire du fidèle allié du général Isaac Brock dans la guerre de 1812, le représente comme un « noble sauvage » : sa tenue traditionnelle autochtone lui donne naturellement un air bon, non corrompu par la civilisation, mais ce même habit le fait aussi paraître différent, voire à part, il est « autre » en quelque sorte. Le Monument à Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, 1893, de Louis-Philippe Hébert (1850-1917), commémore Paul de Chomedey Maisonneuve, soldat de France et fondateur de Montréal.


Canadiennes et Canadiens se sont portés volontaires pour combattre aux côtés des Britanniques lors de la première bataille outre-mer du pays, la guerre d’Afrique du Sud (1899-1902), un conflit entre les colons britanniques et néerlandais en Afrique du Sud, communément appelé la guerre des Boers. À l’époque, le Canada est encore un dominion britannique et sa population se compose en grande partie de sujets britanniques. Les Canadiens anglophones, profondément attachés à ce qu’ils considèrent leur mère patrie, s’enrôlent avec enthousiasme – plus de 7 000 militaires y participeront. La photographie documente le conflit d’un point de vue canadien – c’est entre autres la perspective empruntée dans Les membres de l’unité Lord Strathcona’s Horse en route vers l’Afrique du Sud à bord du S. S. Monterey, 1899, montrant des soldats entassés dans leurs uniformes de serge rêche, quelque part en mer. Comme de coutume, les artistes britanniques dessinent le conflit et leurs œuvres sont reproduites dans les hebdomadaires nationaux. L’un d’eux, Inglis Sheldon-Williams (1870-1940), né en Angleterre, qui deviendra plus tard un artiste canadien de la Première Guerre mondiale, dessine en 1900 le feld-maréchal Frederick Sleigh Roberts, un commandant britannique populaire, couronné de succès. Après le conflit, l’enthousiasme de la population canadienne pour cette entreprise donne lieu à de nombreux monuments commémoratifs de guerre, encore existants aujourd’hui partout au Canada.

La Première Guerre mondiale
La Première Guerre mondiale, 1914-1918, constitue un événement de grande envergure dans l’histoire du Canada. Premier conflit véritablement national du pays, elle implique l’ensemble de sa masse continentale, à l’exception de Terre-Neuve qui, jusqu’en 1949, représentait une colonie britannique – elle combat ainsi avec la mère patrie, et il en résulte un épisode particulièrement sanglant. La guerre débute le 4 août 1914 et, en tant que membre de l’Empire britannique, le Canada tombe en guerre dès que Londres y prend part. S’enrôlent alors plus de 600 000 Canadiens combattant principalement en Belgique et en France; plus de 60 000 d’entre eux mourront au front. Près de 4 000 des soldats engagés sont autochtones, bien qu’ils ne bénéficient pas de l’ensemble des droits et avantages de la citoyenneté dans leur pays.


À quelques exceptions près, les Canadiens anglais se rallient à la cause de la Grande-Bretagne, le conflit renforçant leur appartenance identitaire – ce nationalisme naissant sera cimenté par le succès canadien à la bataille de la crête de Vimy en 1917. Pour la population francophone du Canada, cependant, l’imposition de la conscription militaire entraîne de profondes divisions au pays. Dans un monde post-Confédération plus indépendant, de nombreux Canadiens français ne considéraient pas que ce conflit les impliquait puisque mené par les Britanniques.
Outre les terribles combats et les fortes passions qu’elle suscite, la Première Guerre mondiale donne lieu à une production artistique de grande envergure qui se décline en autant de moyens d’expression : photographie, cinéma, peinture, gravure, reproduction, illustration, affiche, artisanat, sculpture et monument commémoratif. Les artistes sont à l’origine de certaines de ces œuvres, mais les agences gouvernementales et privées en parrainent la grande majorité. Ce faisant, ils établissent le concept de l’artiste ou du programme « officiel ». Cette appellation marginalise la plupart des artistes qui ne peuvent pas revendiquer une telle affiliation et entraîne une compréhension partielle de l’art de guerre canadien. Par conséquent, ce sont surtout la photographie et les arts graphiques sous forme d’affiches, de gravures, de reproductions et d’illustrations qui ont alimenté leur expérience visuelle de la guerre. Par ailleurs, force est de reconnaître l’inaccessibilité des peintures, sculptures ou monuments commémoratifs officiels pour la plupart du public canadien : beaucoup ne pourront contempler ces œuvres que bien après la fin de la guerre, et d’autres ne les verront jamais. Par conséquent, ce sont surtout la photographie et les arts graphiques sous forme d’affiches, d’estampes, de reproductions et d’illustrations qui ont alimenté leur expérience visuelle de la guerre.
En ce qui a trait à l’art officiel, pour consigner les événements de la Première Guerre mondiale, les autorités privilégient deux médias visuels, soit la photographie et le cinéma. Jusqu’en 1915, on autorise les soldats canadiens à porter un appareil photo pendant leur service actif mais, rapidement, la pratique se voit interdite pour des raisons de sécurité. En avril 1916, Lord Beaverbrook, le chef national du Bureau canadien des archives de guerre (BCAG), persuade le ministère de la Guerre de permettre aux photographes et aux cinéastes officiels d’accompagner les forces sur le front. Il est toutefois strict sur ce que les soldats peuvent ou non photographier, intimant : « Couvrez les Canadiens avant de les photographier… mais ne vous préoccupez pas des morts allemands. » Les milliers de mètres d’images saccadées en noir et blanc d’hommes, de machines et de chevaux enregistrées par les directeurs de la photographie paraissent dans le film Lest We Forget, 1934.
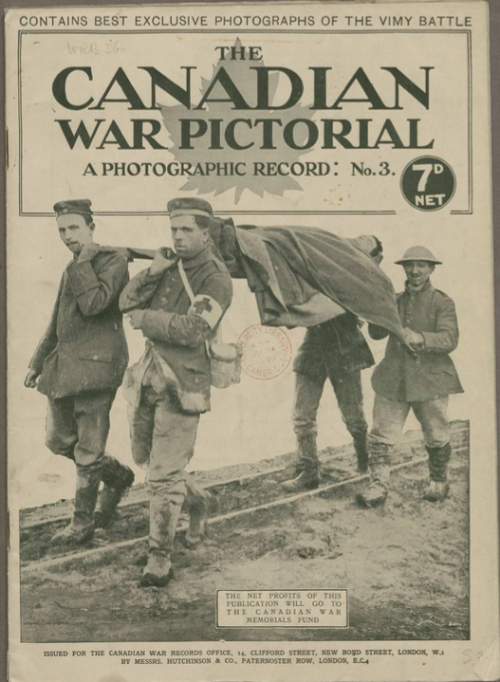

Comme les Canadiens détiennent également le statut de sujets britanniques, l’organisation de Beaverbrook ne juge pas important d’effectuer du recrutement au Canada. Par conséquent, tous les caméramans et les photographes officiels du Canada sont britanniques. L’équipement lourd entrave leurs déplacements, surtout près des lignes de front. Ils opèrent dans un cadre restrictif dictant les endroits où leur présence est bienvenue et les sujets admissibles, ce qui empêche les créateurs de capturer visuellement, et dans son ensemble, la guerre embrasant le nord-ouest de l’Europe. Dans leurs images figurent des bâtiments détruits et des routes transformées en boue, mais peu de cadavres ou de soldats blessés n’ayant pas encore été pansés. Pourtant, grâce au processus de développement relativement rapide, on parvient sans tarder à reproduire les photos de guerre dans des journaux, des magazines et des livres et à les présenter dans des expositions itinérantes populaires. Le BCAG les utilise abondamment dans le Canadian War Pictorial et le Canadian Daily Record, un journal quotidien distribué gratuitement aux troupes. Comme le peintre A. Y. Jackson (1882-1974) le note dans son autobiographie, « la peinture factuelle était révolue et avait été remplacée par la photographie ».

La peinture de guerre connaît une première expérience de courte durée alors que le paysagiste Homer Watson (1855-1936) se fait engager par les autorités canadiennes pour réaliser trois immenses toiles dépeignant l’entraînement militaire au Canada en 1914. La commande est jugée infructueuse par le gouvernement, les critiques et l’artiste. La peinture ne deviendra donc un moyen d’expression signifiant pour consigner la guerre qu’après l’horrible deuxième bataille d’Ypres, en avril et mai 1915, ou lorsqu’elle est commandée par des particuliers.
Au moment de la bataille d’Ypres, les forces canadiennes sont inférieures en nombre, puis décimées par la première utilisation de gaz toxiques par les Allemands, faisant 6 000 victimes canadiennes en quatre jours. L’interdiction récente de photographier les soldats dans des situations violentes, combinée au manque de photographes officiels, rend impossible la documentation de l’événement. Pour corriger cette lacune, en novembre 1916, Beaverbrook se sert de son nouveau programme officiel d’art de guerre, le Fonds de souvenirs de guerre canadiens (FSGC), pour commander à l’artiste et illustrateur canadien anglais Richard Jack (1866-1952) une grande peinture – The Second Battle of Ypres, 22 April to 25 May 1915 (La deuxième bataille d’Ypres, du 22 avril au 25 mai 1915), 1917. Le FSGC était un organisme de bienfaisance britannique soutenu par le gouvernement qui recueillait des fonds auprès de donateurs privés et à travers la vente de publications et de photographies dans le but de commander des œuvres d’art traitant des expériences de guerre canadiennes. La reconstitution de la bataille qu’offre Jack s’inspire vaguement des souvenirs des soldats et d’autres récits de première main. Les soldats lui servent également de modèles. Beaverbrook se dit satisfait du résultat, nonobstant le caractère invraisemblable de la composition qui montre un jeune homme blessé debout sans casque face à l’ennemi, encourageant les autres soldats à se battre. Le FSGC décide de passer des commandes à d’autres artistes dans le but de consigner, pour la postérité, les expériences de guerre du Canada.

Avec près d’un millier d’œuvres d’art, principalement picturales, le programme du FSGC représente une première canadienne, bientôt imitée par d’autres nations alliées. De décembre 1916 à 1920, il emploie plus d’une centaine d’artistes, dont un tiers canadien et le reste essentiellement britannique, notamment Paul Nash (1889-1946) et Algernon Talmage (1871-1939). Un certain nombre de peintres intègrent l’armée en tant qu’artistes de guerre officiels et on les envoie au front pour documenter les activités d’unités spécifiques de l’armée. Ainsi, l’artiste équestre britannique Alfred Munnings (1878-1959) consigne le travail du Corps forestier canadien et du Corps de cavalerie canadien.

Au Canada, un comité distinct associé au FSGC et dirigé par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) commande des scènes du front intérieur et suggère aux autorités des artistes canadiens pour le service outre-mer. Parmi les artistes canadiens qui participent à ce programme, on trouve les futurs membres du Groupe des Sept, A. Y. Jackson, Arthur Lismer (1885-1969), J. E. H. MacDonald (1873-1932) et Frederick Varley (1881-1969), ainsi que la sculptrice Frances Loring (1887-1968) et les peintres Maurice Cullen (1866-1934), Henrietta Mabel May (1877-1971), David Milne (1882-1953) et James Wilson Morrice (1865-1924). Mais, de tous ces peintres, seuls Jackson, Varley, Cullen, Milne et Morrice iront outre-mer. Aucune femme artiste canadienne ne sera officiellement envoyée au front.
Inspirées par les expériences vécues sur les champs de bataille, deux œuvres issues du programme et présentées en 1918, A Copse, Evening (Un taillis, le soir), de Jackson, et For What? (Pour quoi?), de Varley, figurent parmi les peintures de guerre canadiennes les plus connues, toutes époques confondues. Les images de tranchées boueuses, d’arbres détruits et de cadavres rendent de façon saisissante les horreurs de la guerre. Parmi les commandes consacrées au front intérieur, on trouve deux toiles, celle de May, Women Making Shells (Femmes fabriquant des obus), 1919, et celle de Lismer, Convoy in Bedford Basin (Convoi dans le bassin de Bedford), v.1919, cette dernière représentant une flotte de navires camouflés et leurs escortes militaires dans les eaux d’Halifax. Les projets artistiques sur les deux fronts ont nécessité la coopération de l’armée pour placer les artistes à des endroits stratégiques qui leur permettaient d’être témoins du conflit.
Conscient du regain d’intérêt dont jouit l’art graphique en Grande-Bretagne, au Canada et ailleurs, le FSGC commande et vend des estampes originales. Dans ses archives, on trouve une listes de projets datant de juin 1918 qui comporte une proposition de gravures à l’eau-forte de Cyril Barraud (1877-1965), conçue à partir de ses dessins de campagne détaillés et décoratifs, qui traduisent l’irrésistible beauté de la France et des Flandres; des reproductions saisissantes d’illustrations pleines d’action comme Trench Fight (Combat dans les tranchées), 1918, de Harold Mowat (1879-1949); et la distribution de deux images déjà existantes de Caroline Armington (1875-1939) traitant de sujets plus paisibles, notamment No. 8 Canadian General Hospital (Hôpital général canadien no 8), 1918.


La liste mentionne également la production d’estampes à partir des dessins de villes en ruine et de paysages dévastés réalisés sur le terrain par l’artiste de guerre officiel Gyrth Russell (1892-1970). Tous ces projets aboutiront, à l’exception de celui de Mowat. À la fin du conflit, le FSGC met également en vente les reproductions d’un certain nombre de grandes commandes de peinture, telles que la toile de Jack, La deuxième bataille d’Ypres, dans le but de récolter des fonds pour le programme officiel.

Les affiches servent de propagande visuelle : elles sont employées par toutes les nations combattantes voulant encourager les citoyens à consentir des sacrifices pour éviter la défaite et contribuer à la victoire. Les autorités produisent ou commandent des affiches pour appuyer le recrutement, promouvoir la production militaire, informer les citoyens sur la conduite à tenir (comme conserver et préserver les réserves alimentaires) et assurer à la population la justesse des mesures gouvernementales. Les créateurs de ce matériel exploitent le pouvoir des mots et des images pour transmettre des messages visuels percutants, qui évoquent des sentiments de peur, de colère, de fierté et de patriotisme. Pour normaliser la production de propagande, le gouvernement canadien instaure en 1916 le Service des affiches de guerre. Une photographie de la salle des « affiches de guerre », encombrée d’images, du bâtiment des Archives publiques (aujourd’hui le Centre mondial du pluralisme à Ottawa), donne un aperçu de la quantité de matériel propagandiste produit dans le monde entier.
Les mots dominent les premières conceptions d’affiches au Canada et sont accompagnés d’images simples et descriptives aidant à communiquer un message. D’autres compositions jouent sur l’imagerie canadienne ou sur l’iconographie historique du pays afin d’encourager le patriotisme et le sacrifice. Par ailleurs, certaines œuvres reflètent une adhésion aux approches occidentales modernes et plus révolutionnaires qui émergent à cette l’époque, dont beaucoup s’inspirent du militantisme ouvrier, des mouvements de réforme sociale (surtout en milieu urbain) et de diverses causes de la gauche politique. Ainsi, la spectaculaire affiche Pour développer l’industrie, souscrivez à l’emprunt de la Victoire, v.1917, du graphiste Arthur Keelor (1890-1953), montre des travailleurs musclés construisant un pont au sein d’une composition faite de lignes énergiques et d’un lettrage en caractère gras.

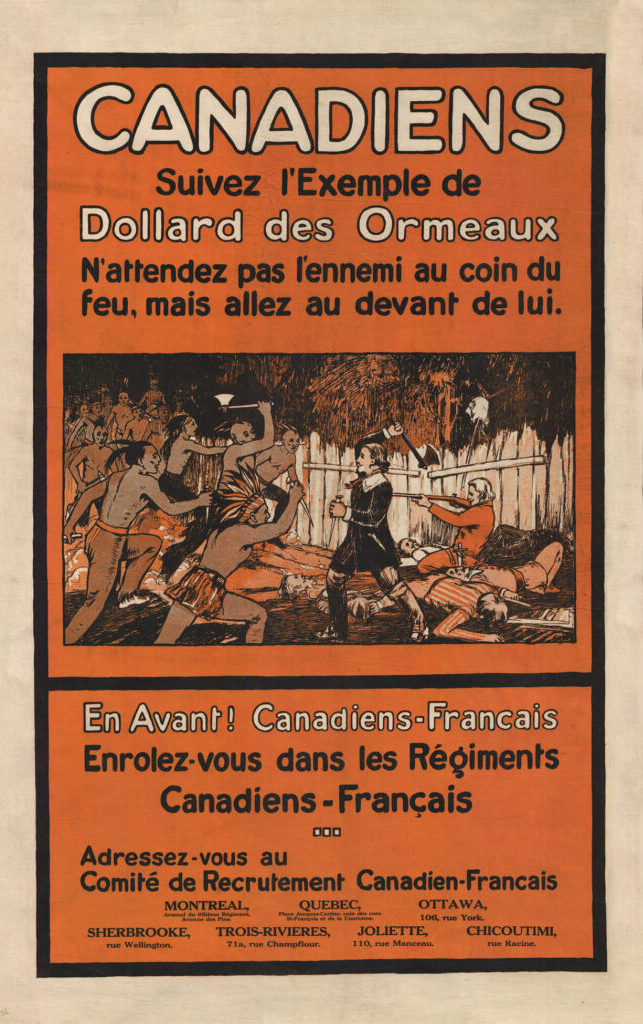
Les affiches de recrutement canadiennes-françaises reflètent la demande pressante de main-d’œuvre du Canada pendant la guerre autant qu’elles font état des tensions sociales, culturelles et politiques sous-jacentes qui affectent l’effort de guerre du pays et influencent la politique. La plupart des Canadiens et Canadiennes francophones n’appuient pas les engagements militaires du Canada à l’étranger, et il en est de même pour les anglophones. Certaines affiches invoquent les traditions martiales du Canada français; d’autres rappellent au peuple canadien-français ses liens historiques et culturels avec la France. Toutes tentent, avec un succès mitigé, de convaincre les francophones que le service militaire est naturel, honorable et nécessaire. Parmi d’autres, Canadiens suivez l’exemple de Dollard des Ormeaux, 1915-1918, exploite l’intérêt du public pour la célèbre prise de position de Dollard des Ormeaux en 1660 contre les Haudenosaunee, et appelle les Canadiens français à imiter son courage. Toutefois, considérant la mort du héros, il est difficile de croire à l’efficacité de cette affiche comme outil de recrutement.
En matière de sculpture, il faudra attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que la discipline s’épanouisse, et ce, principalement en raison du manque de matériaux nécessaires, tel le bronze, utilisés à d’autres fins. Dans les dernières années du conflit, le programme officiel d’art de guerre emploie quelques sculpteurs, mais la plupart ne sont pas canadiens. Le programme acquiert fièrement une importante frise moderniste sculptée, The Canadian Phalanx (La phalange canadienne), 1918, de l’artiste croate Ivan Meštrović (1883-1962).


Beaverbrook fait également appel à un certain nombre de sculpteurs britanniques pour travailler pour le FSGC. Clare Sheridan (1885-1970), notamment, réalise vers 1918 un buste en bronze de l’as de l’aviation canadienne Billy Bishop. Une controverse entoure toutefois une autre commande de sculpture britannique du FSGC, à savoir Canada’s Golgotha (Le Golgotha du Canada), 1918, exécutée par l’éminent artiste Francis Derwent Wood (1871-1926). Pendant la deuxième bataille d’Ypres en 1915, des rumeurs ont circulé à l’effet qu’un soldat canadien aurait été crucifié sur la porte d’une grange belge (le sujet de la sculpture de Wood) – une histoire que les Allemands ont dénoncé après la guerre comme étant pure propagande. L’œuvre a été rapidement mise en réserve.
Deux sculptrices d’origine américaine vivant au Canada, Frances Loring et Florence Wyle (1881-1968), se font connaître lorsqu’elles reçoivent, en 1918, une commande officielle du FSGC pour l’exécution de quatorze figures en bronze d’hommes et de femmes œuvrant dans les fermes ou dans des usines de munitions. Loring crée également pour le fonds Noon Hour in a Munitions Plant (L’heure du midi dans une usine de munitions), v.1918–1919, une grande frise en bronze représentant des ouvriers de manufacture pendant leur pause du midi et, la même année mais cette fois à titre personnel, elle réalise une sculpture émouvante d’une femme en deuil intitulée Grief (Deuil). Ces sculptures donnent un aperçu unique du front intérieur canadien durant le conflit.

Les personnes associées à aucun programme officiel – les artistes non officiels – produisent une bonne partie de l’art de la Première Guerre mondiale. Étudiants en art, médecins, architectes, peintres en bâtiment ou ouvriers agricoles avant la guerre, les artistes soldats et civils sont issus d’horizons fort divers. Pendant et après la guerre, nombre d’entre eux trouvent le temps et les outils nécessaires pour partager visuellement leurs expériences avec leurs camarades, leur famille, leurs amis et, parfois, les autorités. Par ailleurs, beaucoup deviennent en temps et lieu artistes de guerre officiels canadiens.
Thurston Topham (1888-1966), illustrateur d’avant-guerre chez Scribner’s, s’enrôle dans la 1re Batterie de siège canadienne, où il utilise ses talents artistiques pour produire des croquis d’observation utiles aux services de renseignements militaires, comme Opening of the Somme Bombardment (Début du bombardement de la Somme), 1916, lors de la bataille de la Somme. Arthur Nantel (1874-1948), pour sa part, est capturé lors de la deuxième bataille d’Ypres en 1915 et passe le reste de la guerre dans un camp de prisonniers : durant cette période, en échange de nourriture, il peint des scènes de vie, telles que Christmas Eve in Giessen Camp (Veille de Noël au camp de Giessen), 1916. Enfin, John Humphries (1882-1958) note sa profession de caméraman sur ses papiers d’enrôlement. En 1919, il peint plusieurs œuvres directement sur les murs de la maison à l’intérieur de laquelle il est cantonné, en utilisant des couleurs tirées de matériaux trouvés à proximité qu’il mélange lui-même. Plus tard, on lui rapportera qu’à la suite du départ de son régiment, la maison devient « un sanctuaire pour les Canadiens », et ce, grâce à ces peintures.


Pour d’autres, la guerre inspire des réalisations ultérieures. Le Suisse André Biéler (1896-1989), combattant blessé à la crête de Vimy en 1917, puis gravement gazé à Passchendaele, en Belgique, sera plus tard dans l’année transféré pour des raisons de santé à la section topographique du Corps canadien à titre d’illustrateur technique. Arras, Ruins (Ruines d’Arras), 1917, représente l’un des rares dessins détaillés de cette époque. C’est dans ce contexte qu’il décide de devenir artiste après la guerre – une ambition qu’il réalise avec beaucoup de succès en tant que peintre et professeur d’art à l’Université Queen’s, à Kingston. Frederick Clemesha (1876-1958) fait quant à lui partie du 46e bataillon, surnommé le « bataillon suicide » en raison de son taux de morts et de blessés qui s’élevait à 91,5 %. Clemesha survivra et deviendra architecte à Regina. Il concevra le Mémorial canadien à Saint-Julien, connu sous le nom Le soldat en méditation, 1923, en commémoration de la participation du Canada à la deuxième bataille d’Ypres, en Belgique, d’avril à mai 1915.

L’artiste Mary Riter Hamilton (1873-1954) n’est pas militaire mais civile. Le FSGC lui refuse le statut d’artiste officielle en 1917 mais, pendant les six années de pauvreté suivant la guerre, elle peint la France et la Belgique dévastées, seule ou presque parmi les tombes. Sa toile Sanctuary Wood, Flanders (Bois du sanctuaire, Flandres), 1920, notamment, avec ses troncs d’arbres fantomatiques massés dans un paysage désolé, se compare à Un taillis, le soir, 1918, de Jackson. Hamilton fait pression pendant des années pour que ses trois cents tableaux soient placés dans une collection nationale, mais on rejette sa demande dans un premier temps, jusqu’en 1926, année où Bibliothèque et Archives Canada accepte finalement de les héberger.


En plus des artistes non officiels, diverses organisations privées soutiennent également les arts en temps de guerre. Des initiatives de collecte de fonds, telles que le Fonds patriotique canadien, commandent leurs propres affiches promotionnelles. L’une d’elles, Le Canada et l’appel, 1914, réalisée par J. E. H. MacDonald, présente le Canada sous les traits d’une femme parée de symboles patriotiques, dont la feuille d’érable et la fleur de lys. La représentation des peuples autochtones sur une autre affiche du Fonds patriotique canadien datant de 1916 est, aux yeux du public d’aujourd’hui, véritablement odieuse. Sur l’image intitulée Moo-che-we-in-es. Pale Face, My skin is dark but my heart is white, for I also give to Canadian patriotic fund (Moo-che-we-in-es. Visage pâle, ma peau est sombre mais mon cœur est blanc, car je donne aussi au Fonds patriotique canadien) figure un guerrier autochtone.

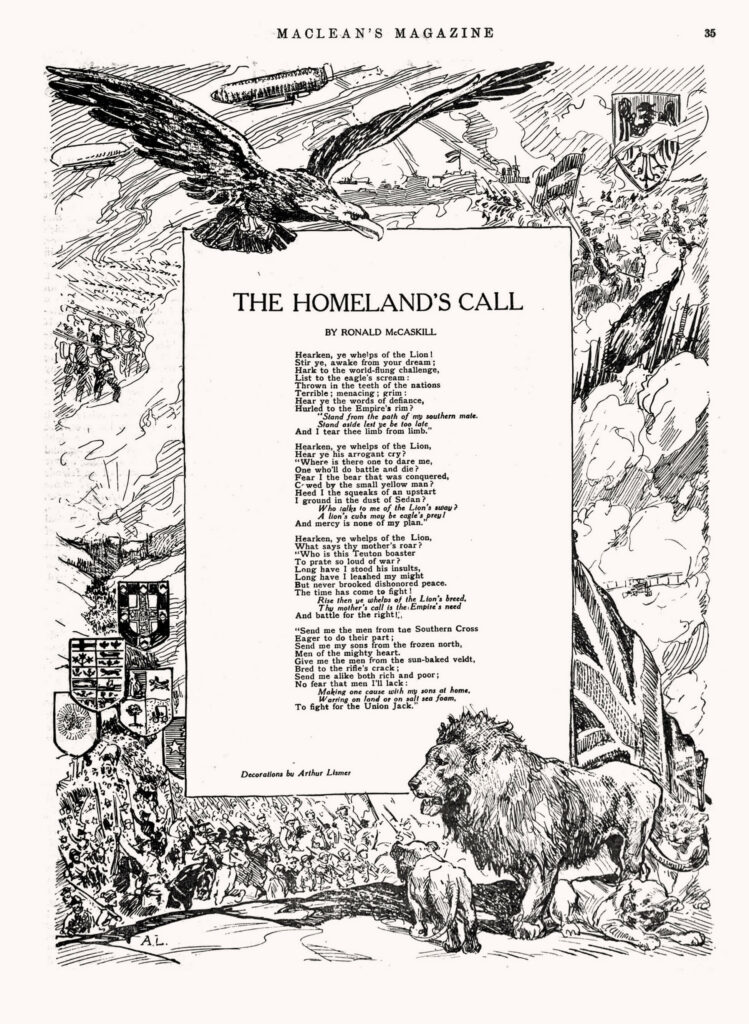
Lors de la Première Guerre mondiale, l’illustration prospère en tant qu’activité du front intérieur grâce à l’évolution de petites entreprises canadiennes d’édition de magazines. Maclean’s, entre autres, emploie un certain nombre d’artistes commerciaux qui participeront ensuite au programme officiel d’art de guerre, comme Arthur Lismer. Un mois après le début de la guerre, Lismer produit pour le magazine un collage émouvant d’images patriotiques pour illustrer un poème de Ronald McCaskill – The Homeland’s Call, 1914.
Le Canadian Magazine, un périodique national populaire auprès des lecteurs instruits, voyageurs et bien nantis, publie The Kaiser’s Battle Cry (Le cri de guerre du Kaiser), 1914, de J. E. H. MacDonald.
Sur l’image paraît la devise « Forward with God [En avant avec Dieu] » et, au-dessus de celle-ci, l’image de l’empereur allemand conduit par la mort incarnée par un squelette, avec le diable à ses côtés, qui chevauche son cheval à travers un champ de bataille dévasté et jonché de cadavres. Sur le côté de la composition est reproduit un poème satirique intitulé The Kaiser’s Last Ultimatum de Van der Tod, peut-être le nom de plume de MacDonald.
Le magazine appuie également les femmes artistes. Marion Long (1882-1970) réalise trois dessins touchants en 1915 illustrant les réactions des femmes à la guerre : Looking at the War Pictures (Regarder les photos de guerre), scène d’une mère et de son enfant en train de regarder des images de bataille; Home on Furlough (À la maison en permission), qui décrit la joie d’une épouse au retour de son mari en permission; et Killed in Action (Tué au combat), montrant une femme réagissant à la nouvelle de la mort de son mari. Le FSGC, organisation très masculine, refuse de commander des œuvres de ce type.
Le numéro de décembre 1918 du Canadian Magazine souligne plus avant la différence entre l’art officiel de guerre, que le public n’a pas encore vu, et celui des artistes non officiels, déjà accessible au Canada. Frederick Varley, par exemple, artiste commercial et peintre peu connu pendant la majeure partie des années de guerre, illustre une douce histoire qui mêle gentillesse, faiblesse et tromperie écrite par le journaliste et ancien combattant de la Première Guerre mondiale Carlton McNaught. Dans les deux illustrations figure le protagoniste de l’histoire, l’ordonnance (un serviteur d’officier) nommé Private Peach. Celle à l’encre et au lavis, intitulée “I don’t think I ever saw a man less suited to be a gentleman’s valet” (« Je ne pense pas avoir jamais vu un homme moins apte à être le valet d’un gentleman »), montre le personnage esseulé et abattu, tandis que l’autre, un dessin au trait, le représente docile auprès de l’officier qu’il assiste. Varley n’a aucune expérience du conflit à l’étranger lorsqu’il crée ces illustrations mais, au moment où le récit est publié, il se trouve à Londres à titre d’artiste de guerre officiel.


Durant la Première Guerre mondiale, des caricaturistes étrangers, comme le Belge Louis Raemaekers (1869-1956) et l’Anglais Bruce Bairnsfather (1887-1959), dominent le marché de la production et de la publication de dessins satiriques. Une caricature anonyme unique intitulée Summer in England (Été en Angleterre), s.d., présentant deux soldats canadiens en train de laver leur linge, apporte une pointe d’humour en cette période difficile. Toutefois, nous ignorons aujourd’hui si le dessin a même été publié. En 1916, Kenneth Browne (1900-1965), encore mineur, s’enrôle et sert dans le Corps médical de l’Armée canadienne, où il amuse régulièrement ses camarades avec de nouvelles caricatures : celles-ci formeront une série qu’il publiera en autoédition après la guerre sous le titre Krushing Kaiserism, 1918.


3 x 77,2 x 3 cm, Musée canadien de la guerre, Ottawa.
La fabrication d’objets à la main atteint de nouveaux sommets pendant et immédiatement après la Première Guerre mondiale, ces formes les plus familières étant l’art des tranchées (objets utilitaires ou purement esthétiques fabriqués par les soldats à partir de débris trouvés sur les lieux du conflit), la broderie thérapeutique et les vitraux commémoratifs. En dépit de son nom, la plupart des œuvres d’art des tranchées ne sont pas réalisées dans les tranchées, mais au cours de périodes passées loin des champs de bataille. Les soldats créent ces pièces pour diverses raisons : par exemple, certains les produisent en souvenir d’une bataille importante ou alors ils espèrent les vendre et augmenter leurs revenus. Dans le sens large du terme, l’art des tranchées comprend également les sculptures réalisées par les prisonniers de guerre.
Pendant la durée de leur service, les soldats sont essentiellement nomades, c’est-à-dire qu’ils vont et viennent entre la ligne de front, les congés, la convalescence ou l’emprisonnement. Sur le terrain, ils doivent pouvoir transporter la totalité de leur matériel – un poids d’environ 27 kilogrammes. Tout ce qui n’est pas essentiel est jeté. Par conséquent, leurs œuvres d’art doivent être petites, portables et, de préférence, utiles. Aussi les étuis à cigarettes s’avèrent entre autres populaires. Pendant la guerre, l’armée allemande est la première à utiliser l’aluminium dans les avions; après un accident, ces pièces d’un métal léger et malléable deviennent très prisées par les troupes alliées créatives au sol. L’aluminium peut être façonné très facilement en couvercle de boîte d’allumettes, et notons à ce sujet qu’Harry Ritz grave son nom sur la surface d’un de ces objets d’art des tranchées. Les prisonniers de guerre et les internés au Canada fabriquent également des objets qu’ils conservent ou qu’ils vendent quand ils le peuvent à ceux chargés de les soigner. Un prisonnier de guerre autrichien non identifié crée une canne en bois et en métal ouvragée pour un membre des Rocky Mountain Rangers de l’Alberta. Sur celle-ci, un serpent de métal vert s’enroule sinueusement sur presque toute la longueur, le pommeau en forme de tête de chien, et la pointe telle une balle et une douille.
La fabrication d’objets décoratifs dans le cadre de traitements d’ergothérapie se développe pendant la Première Guerre mondiale. Le remarquable antependium brodé de fleurs commandé par le roi George V pour le service de l’Action de grâce à la cathédrale Saint-Paul de Londres, en 1919, constitue un particulièrement bel exemple d’œuvre d’art réalisée par des soldats en état de stress post-traumatique. Au total, 138 Australiens, Britanniques, Canadiens et Sud-Africains gravement blessés produisent de petites sections de damas brodé, qui seront ensuite cousues ensemble à la Royal School of Needlework. Les soldats canadiens sont les premiers militaires à travailler sur le parement.

Un grand nombre de villes et de villages commémorent leurs morts dans les vitraux des églises et des bâtiments publics. En 1922, la Welcome Zion Congregational Church à Ottawa érige trois vitraux commémoratifs, conçus par la Colonial Art Glass Company de la capitale, où figurent les noms de huit membres de la congrégation morts au combat. Sur l’un des trois panneaux et sous la date de 1918 paraissent quatre d’entre eux. Un délicat réseau gothique mêlé aux feuilles d’un chêne orne richement le vitrail, duquel saillit le mot « liberté ».
Le résident et médecin américain Robert Tait McKenzie (1867-1938) est le sculpteur canadien le plus reconnu sur la scène internationale tant pendant qu’après la Première Guerre mondiale, un conflit d’ailleurs auquel il participe au sein du corps médical de l’armée britannique. En effet, McKenzie adapte ses talents de sculpteur afin d’aider les chirurgiens à remodeler les visages des soldats défigurés par les obus. Il exécute un certain nombre de petites sculptures de guerre d’une grande intensité émotionnelle, dont un portrait posthume du capitaine canadien Guy Drummond, réalisé après avril 1915, et la pièce Wounded (Blessé), 1921, tout comme il conçoit quelques remarquables monuments de guerre figuratifs en Angleterre, en Écosse et aux États-Unis. Toutes ces œuvres curieusement intimes sont profondément marquées par ses expériences de guerre personnelles. Pour quelqu’un dont la carrière médicale visait à encourager l’amélioration du physique masculin, voir celui-ci mutilé par la bataille a dû être dévastateur.


L’étonnante sculpture de guerre War the Despoiler (La guerre spoliatrice), 1915, du Canadien Emanuel Hahn (1881-1957), dans laquelle un dieu de la guerre arrache ses victimes du ventre d’un nu féminin prostré, ne trouve pas à l’époque l’appui du public : elle ne sera donc jamais coulée. Néanmoins, en 1928, à la suite de nombreuses et importantes commandes de monuments commémoratifs d’après-guerre, les sculpteurs canadiens, dont Hahn, parviendront à former une organisation d’exposition, à savoir la Société des sculpteurs du Canada.
Les commandes de monuments commémoratifs de guerre surviennent à la fin de la Première Guerre mondiale. Les artistes canadiens les obtiennent rarement, et ce, en partie parce que très peu d’entre eux peuvent répondre à la demande. Par conséquent, plus de la moitié des monuments commémoratifs au Canada sont produits par des fabricants de monuments italiens. En outre, c’est un sculpteur britannique, Vernon March (1891-1930), qui conçoit le Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa. En 1925, Hahn remporte le projet du cénotaphe de Winnipeg, mais deux ans plus tard, l’opinion publique l’oblige à se retirer en raison de son origine allemande. Malgré cela, les succès des monuments de guerre de Hahn sont beaucoup plus nombreux que ceux de tous les autres sculpteurs canadiens.

Le monument de guerre canadien le plus vénéré, le Mémorial national du Canada à Vimy,1921-1936, en France, est l’œuvre d’un sculpteur né au Canada, Walter S. Allward (1874-1955). Chacune des lignes des vingt figures allégoriques expriment avec puissance l’écrasant chagrin du pays. Leurs poses témoignant de leur douleur contrastent fortement avec l’architecture simple dans laquelle elles s’inscrivent, une structure pensée comme un site de deuil, à l’instar des cimetières spectaculaires mais minimalistes entourant le monument. Toutefois, nonobstant son immense splendeur, le monument raconte une histoire d’hommes. Même le Monument commémoratif de guerre Welland-Crowland, 1939, d’Elizabeth Wyn Wood (1903-1966), présentant une protagoniste féminine se cachant derrière un soldat à la posture héroïque, ne parvient pas à contrebalancer l’hégémonie masculine qui caractérise le mémorial canadien de la Première Guerre mondiale, tant à l’étranger qu’au pays.


La Seconde Guerre mondiale
On associe le mot « liberté » à la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, qui éclate vingt ans seulement après la fin de la Première Guerre mondiale. À la suite des 60 000 morts, des centaines de milliers de blessures de guerre, tant mentales que physiques, et la Grande Dépression des années 30, la Seconde Guerre mondiale est perçue comme une nécessité – sans pour autant être désirée – pour garantir la liberté face à la double tyrannie mondiale du fascisme et de la dictature.

Le Canada déclare la guerre à l’Allemagne le 10 septembre 1939, à la suite de l’invasion allemande de la Pologne le 1er septembre. Ce faisant, il s’allie à la Grande-Bretagne et la France pour s’opposer à l’agression allemande. Bien que mal préparé à la guerre, souffrant des conséquences de la Dépression, le Canada met sur pied d’importantes forces terrestres, navales et aériennes. Le pays tout entier s’implique dans l’effort de guerre alors que ses industries et son agriculture, qui revêtent une importance essentielle, se développent pour fournir aux puissances alliées des navires, des avions, des sites d’entraînement, des véhicules, des armes, des matières premières et de la nourriture. La guerre s’avère extrêmement coûteuse sur le plan humain : sur les 1,1 million de Canadiens qui serviront, soit 10 % de la population, 42 042 mourront et 54 414 reviendront blessés.
La communauté artistique s’implique autant qu’avant et exerce ainsi de fortes pressions pour obtenir un programme d’art de guerre semblable à celui du FSGC de la Première Guerre mondiale. Elle devra cependant attendre la fin de 1942 pour voir la création de la Collection d’œuvres canadiennes commémoratives de la guerre. En revanche, on soutient d’emblée la photographie, et les artistes de guerre officiels du Canada reçoivent des caméras. En matière de design, la Seconde Guerre mondiale représente aussi une époque prospère : la discipline s’épanouit au sein de programmes de propagande sophistiqués notamment axés sur la production d’affiches et de films. Par ailleurs, des cours d’art pour le personnel militaire sont élaborés et promus, et on organise des expositions ainsi que des concours d’art des forces armées. La sculpture, elle, brille par son absence : dans l’ensemble, le conflit fournit peu d’occasions de créer de nouveaux monuments commémoratifs et c’est ainsi que les nouveaux noms et dates ont plutôt été ajoutés aux monuments existants.
Au moment où la guerre éclate, les peuples autochtones du Canada subissent depuis des décennies des pratiques assimilatrices qui concourent à amoindrir ou effacer leur contribution, pourtant évidente, à la société. Nous savons que plus de trois mille Autochtones se sont engagés dans l’armée, mais ce chiffre ne tient pas compte des milliers de Métis, d’Inuits et d’Indiens non-inscrits. Pour ces citoyens, rien n’est aisé, pas même l’enrôlement. L’Aviation royale canadienne (ARC) et la Marine royale canadienne (MRC) exigent que les volontaires soient « de pure descendance européenne et de race blanche » jusqu’en 1942 et 1943, respectivement. Dans l’art, à l’exception de quelques portraits, nulle part ne rend-t-on véritablement hommage à la contribution des Autochtones à l’effort militaire ou ne souligne-t-on clairement leur implication dans les œuvres de guerre. Retenons comme exemple de ce phénomène le cas particulièrement effarant du portrait réalisé par l’artiste né en Australie Henry Lamb (1886-1963), d’abord intitulé A Redskin in the Royal Canadian Artillery (Un Peau-Rouge dans l’Artillerie royale canadienne), 1942. En 1999, on parvient finalement à identifier le soldat en question et l’œuvre est alors rebaptisée Trooper Lloyd George Moore, RCA (Cavalier Lloyd George Moore, ARC). L’œuvre Trooper O.G. Govan (Cavalier O. G. Govan), 1941, de Lamb, est un autre exemple rare de la représentation d’un soldat canadien de couleur.


Au Canada, sur le front intérieur, les femmes artistes acquièrent une notoriété bien supérieure à celle qu’elles connaissaient lors des conflits précédents, et pourtant, leurs droits demeurent restreints comparativement aux hommes – elles ne peuvent documenter l’histoire de la guerre qu’au Canada, pas outre-mer. Néanmoins, ces dernières contribuent significativement à la compréhension générale de la guerre au pays. Si les agences gouvernementales veillent à embaucher certaines femmes pour dépeindre les services des femmes, ce sont les artistes civiles féminines qui parviennent à mieux traduire l’expérience entière de la guerre. L’œuvre Lunchtime, Cafeteria at the Chateau Laurier, Ottawa (L’heure du dîner à la cafétéria du Château Laurier, Ottawa), 1944, d’Elizabeth Harrison (1907-2001), notamment, dépeint l’interaction de femmes, d’hommes et de soldats sans uniforme.

La photographie et le cinéma dominent les documents visuels officiels canadiens pendant la Seconde Guerre mondiale. La photographie bénéficie grandement des progrès technologiques réalisés depuis la Première Guerre mondiale. Au cours des années 1920 arrivent sur le marché des appareils photo légers et à déclenchement rapide comme le Leica (1925) et le Rolleiflex (1928). De plus, la création de l’Office national du film (ONF) en 1939 joue un rôle important dans l’essor de l’industrie cinématographique canadienne.
Au début du conflit, tant au Canada qu’à l’étranger, les productions photographique et cinématographique relèvent de directions distinctes. La Section photographique des relations publiques de l’armée emploie des photographes, tandis que l’Unité de film de l’armée canadienne consigne les événements à l’aide de caméras cinématographiques. Les deux organisations fusionnent en 1943 pour former l’Unité de film et de photographie de l’Armée canadienne, qui emploiera quelques deux cents personnes. Chaque branche de l’armée – l’armée de terre, l’armée de l’air et la marine – nomme ses photographes et caméramans, des professionnels généralement peu connus aujourd’hui. En général, on associe deux caméramans à un photographe, et chaque unité dispose d’un chauffeur et du soutien de techniciens chargés du développement des films. Parmi les photographes, on ne compte qu’une seule femme, Karen Hermiston (1916-2007), un fait certes peu surprenant. Au nombre de ses sujets figure la seule femme artiste de guerre officielle du Canada, Molly Lamb Bobak (1920-2014), qu’elle photographie à Londres, en Angleterre, alors qu’elle travaille à sa toile Boat Drill, Emergency Stations (Exercice d’embarcation, postes d’urgence), 1945.


L’Office national du film, une organisation de taille modeste à l’origine, connaît une croissance exponentielle sous la direction de son commissaire à la cinématographie, l’Écossais John Grierson (1898-1972). En 1941, l’ONF remplace le Bureau de cinématographie du gouvernement canadien pour former, en 1945, l’un des plus grands studios du monde avec 750 employés. Pendant la guerre, l’ONF distribue plus de cinq cents films, dont la série Canada Carries On (v.f. En avant Canada), 1940-1959, comprenant de nombreux épisodes réalisés par la cinéaste Jane Marsh Beveridge (1915-1998). Sensible aux défis imposés aux femmes durant la guerre, lesquelles se voient soudainement arrachées à leur rôle domestique traditionnel, elle signe notamment Les femmes dans la mêlée, 1942; Carrières de femmes, 1943; et Nos femmes ailées, 1943, avant de démissionner de l’ONF en 1944, lorsque Grierson refuse de lui confier officiellement la responsabilité de la série, et ce, parce qu’elle est une femme.

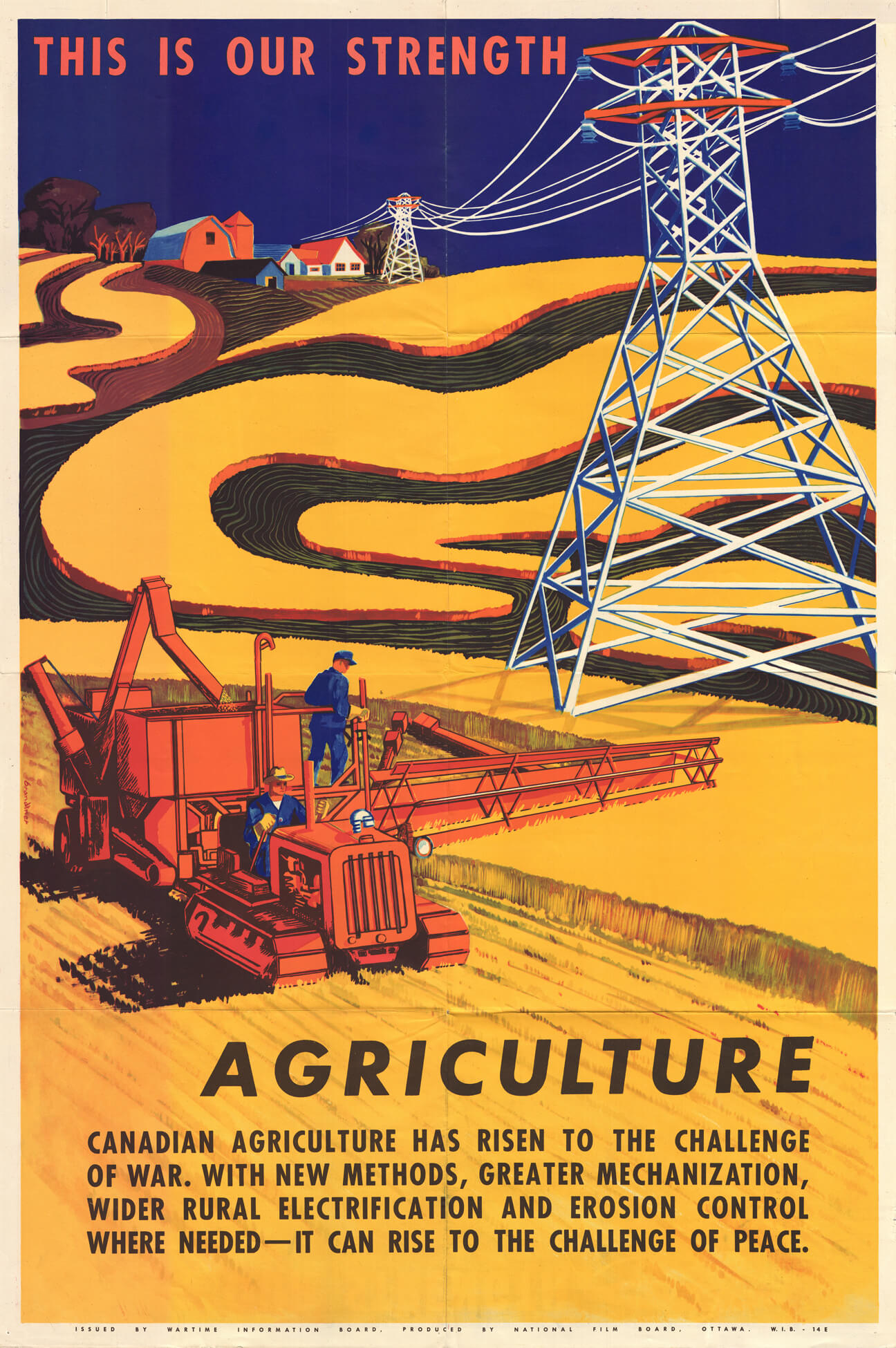
Les affiches sont omniprésentes pendant la Seconde Guerre mondiale – de nombreux artistes participent à leur production tout au long du conflit. Albert Cloutier (1902-1965), qui deviendra plus tard artiste de guerre officiel, agit à titre de superviseur gouvernemental de la production d’affiches de guerre de 1940 à 1944. Au cours des premières années, le directeur du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC), H. O. McCurry (1889-1964), s’implique également dans la gestion de la conception d’affiches et tient à employer des artistes canadiens. L’ONF engage de nombreux concepteurs canadiens – Fritz Brandtner (1896-1969), entre autres, crée l’affiche de production alimentaire This Is Our Strength – Agriculture (C’est notre force – agriculture), s.d.
Le recrutement constitue sans doute le thème le plus exploité dans les affiches. Deux images réalisées par des artistes canadiens associent certains motifs héroïques classiques ou historiques à des circonstances contemporaines pour encourager la population à s’enrôler. Eric Aldwinckle (1909-1980), plus tard fait artiste de guerre officiel, réalise l’une de ces représentations, intitulée Canada’s New Army Needs Men Like You (La nouvelle armée du Canada a besoin d’hommes comme vous), v.1941-1942, présente un soldat sur une motocyclette en équilibre sur la roue arrière, aux côtés de l’image fantomatique d’un chevalier médiéval sur un cheval qui se cabre. Une autre œuvre, The Spirit of Canada’s Women (L’inspiration des femmes du Canada), 1942, de Gordon K. Odell (1898-1981), montre des rangs de soldates défilant avec le spectre de l’héroïne française médiévale Jeanne d’Arc.
Durant la Seconde Guerre mondiale, l’essentiel de la peinture tient dans le programme d’art officiel du Canada, la Collection d’œuvres canadiennes commémoratives de la guerre, qui regroupe environ 5 000 petites peintures représentant des événements, des lieux, de la machinerie et du personnel militaire, tant sur le front des batailles que sur celui intérieur. A. Y. Jackson participe activement au lancement du programme et conserve un rôle consultatif, suggérant à quels artistes commander les œuvres. Charles Comfort (1900-1994) est pour sa part chargé d’identifier le matériel à fournir aux peintres, mais il se rend également lui-même outre-mer à titre d’artiste de guerre officiel de l’armée. Avant cela, cependant, il conçoit la seule médaille canadienne de la Seconde Guerre mondiale – la Médaille canadienne du volontaire, d’abord présentée en 1943, qui figure un groupe d’hommes et de femmes en uniforme marchant ensemble. Les autorités décerneront au total 650 000 de ces médailles.
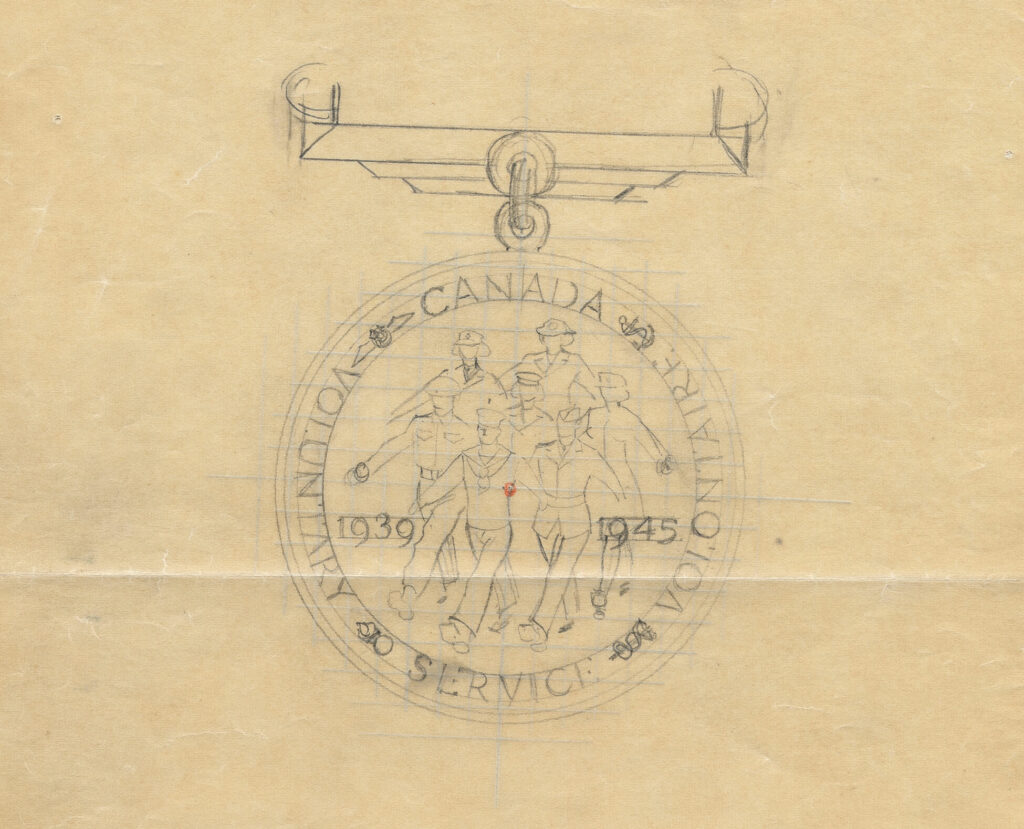
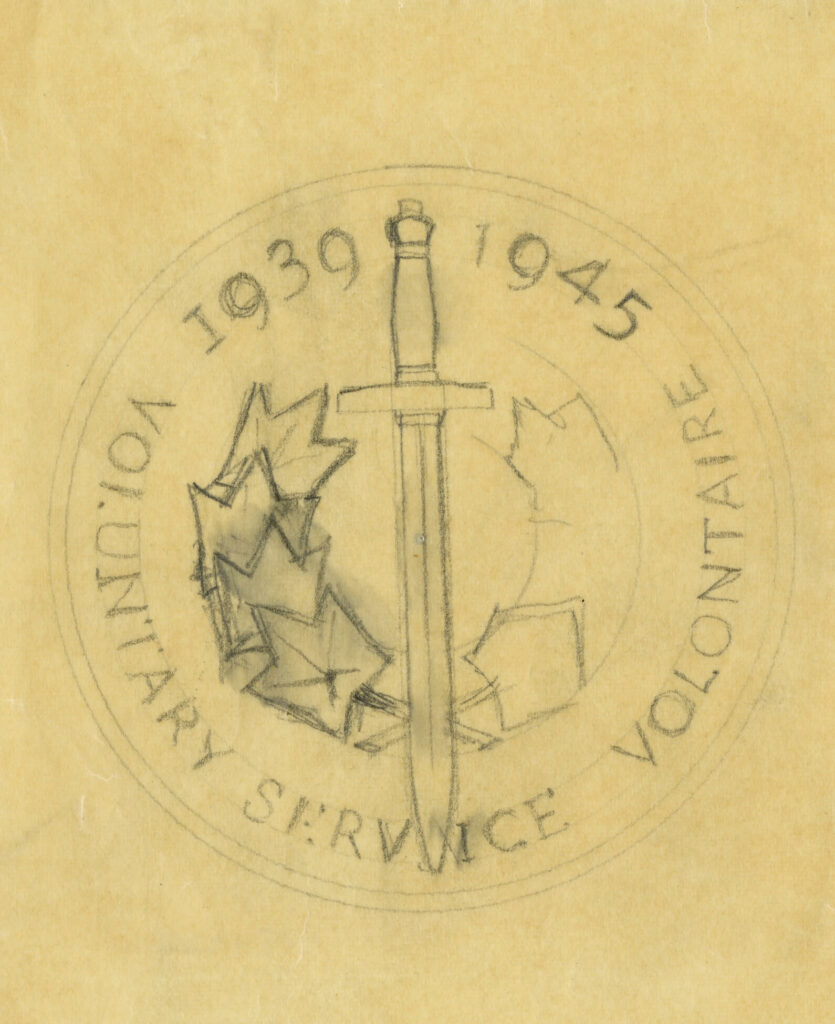
Parmi les trente-deux artistes de guerre officiels employés, tous officiers, figurent Aba Bayefsky (1923-2001), Miller Brittain (1912-1968), Bruno Bobak (1923-2012), Alex Colville (1920-2013) et Jack Nichols (1921-2009). Répartis entre les trois services – l’armée de terre, la marine et l’armée de l’air – et servant sur tous les théâtres de guerre occidentaux, y compris la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Europe du Nord-Ouest et l’océan Atlantique, ces peintres reçoivent du matériel et répondent à des instructions. Généralement intégrés à des unités désignées de l’armée, à des navires ou à des escadrons de l’armée de l’air, ces derniers se voient affectés à des fonctions très similaires à celles de leurs prédécesseurs de la Première Guerre mondiale. Les instructions officielles déterminent la quantité d’œuvres à produire, la taille de celles-ci et leurs sujets, laissant une certaine marge d’interprétation. Les artistes civils étant confrontés à de graves pénuries de matériaux tels que le papier, nombre d’entre eux se joignent aux programmes officiels en vue d’obtenir des fournitures plus abondantes.


La plupart des artistes, habitués à peindre des paysages, des natures mortes ou des portraits, manquent de préparation quant à la représentation de sujets de guerre. La précision passe avant tout : beaucoup de participants choisissent alors d’exécuter des dizaines de petits croquis détaillant minutieusement les équipements, les uniformes et les véhicules avant d’achever leurs toiles, qui seront ensuite bien accueillies par le public et largement exposées. Dans ce contexte, une grande partie de l’art officiel est de nature illustrative. Si des approches artistiques contemporaines telles que l’abstraction avaient été exploitées, les autorités auraient vraisemblablement rejeté les œuvres. Ainsi refuse-t-on d’abord la peinture romantique d’un avion, Per Ardua Ad Astra [À travers l’adversité, jusqu’aux étoiles], 1943, de Carl Schaefer (1903-1995), jugée problématique : cette représentation d’un Spitfire MK.IX avec le bout des ailes coupées, en train de monter et de déraper à tribord, rendait, selon eux, l’appareil trop difficile à identifier.
Contrairement aux dessins de la Première Guerre mondiale, qui ont été conservés pour la plupart seulement à titre d’ébauches de peintures achevées, pendant la Seconde Guerre mondiale, les compositions sur papier des archives de guerre canadiennes sont souvent considérées comme des œuvres d’art abouties. Par exemple Charles Goldhamer (1903-1985) s’enrôle dans l’Aviation royale du Canada en 1943 comme superviseur des programmes d’art pour le personnel de l’armée de l’air avant d’être nommé artiste de guerre officiel; à ce titre, il dessine alors des pilotes et des équipages gravement blessés à l’unité de chirurgie plastique avancée de l’Aviation royale du Canada à East Grinstead, dans le West Sussex, en Angleterre, où un Canadien, Albert Ross Tilley, compte parmi les chirurgiens pionniers. L’œuvre de Goldhamer, Face Burns, Sgt. James F. Gourley, RAF, 536215 (Brûlures au visage, sgt James F. Gourley, RAF, 536215), 1945, représente un sergent de la Royal Air Force qui a subi trente-sept opérations dans cette unité.

Molly Lamb Bobak est la seule femme artiste de guerre officielle employée par les Archives de guerre canadiennes; cette ancienne soldate du Service féminin de l’Armée canadienne voyage outre-mer après la fin de la guerre en Europe en mai 1945 (elle épouse Bruno Bobak en décembre). Son long bilan de service militaire au Canada, son éducation artistique formelle et son amitié avec A. Y. Jackson contribuent à lui assurer des commandes. Retenons Private Roy, Canadian Women’s Army Corps (Soldat Roy, Service féminin de l’Armée canadienne), 1946, comme l’une de ses œuvres les plus remarquables. Il s’agit d’un portrait envoûtant d’une Canadienne noire travaillant derrière le comptoir d’une cantine militaire. La sergente – et non la soldate – Eva May Roy compte parmi les rares Noires enrôlées dans le Service féminin de l’Armée canadienne. Aussi Bobak rétrograde-t-elle Roy en qualifiant son sujet de simple soldate.
Chargés de documenter la guerre au sens large à travers la peinture, les artistes de la Collection d’œuvres canadiennes commémoratives de la guerre s’écartent parfois du thème de l’activité militaire pour se tourner vers des sujets plus humains. La fabrication d’objets à la main constitue un élément clé des programmes de réadaptation des soldats, comme en témoigne la toile R.C.A.[F.] Officer Doing Handicraft Therapy, No. 1 Canadian General Hospital, Taplow, England (Officier de l’ARC suivant une thérapie par l’artisanat, Hôpital général canadien no 1, Taplow, Angleterre), de l’artiste de guerre officiel George Campbell Tinning (1910-1996).
Les estampes originales d’artistes caractéristiques du programme de la Première Guerre mondiale – lithographies, eaux-fortes et pointes sèches – deviennent plus rares pendant la Seconde Guerre mondiale. Citons tout de même les deux plus connues, soit la lithographie intitulée Crankshaft for Corvette, Marine Engine (Vilebrequin pour corvette, moteur marin), 1942, de l’artiste de guerre officiel Carl Schaefer, et celle d’Aba Bayefsky Dismembering “U” Uncle (La démolition du « U » Uncle), v.1943-1945. La première provient d’un dessin réalisé plus tôt la même année lors d’une visite à l’usine manufacturière John Inglis de Toronto; la seconde, qui présente un champ de bataille, s’inspire d’un dessin du même titre montrant une équipe de l’armée de l’air en train de démonter un avion.
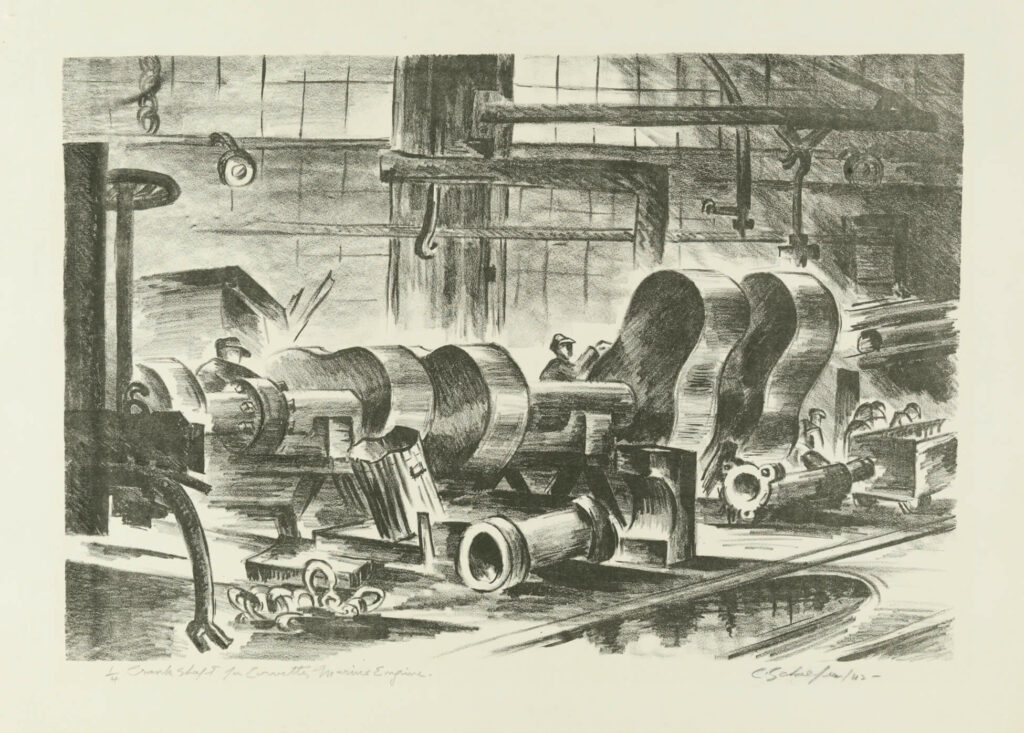
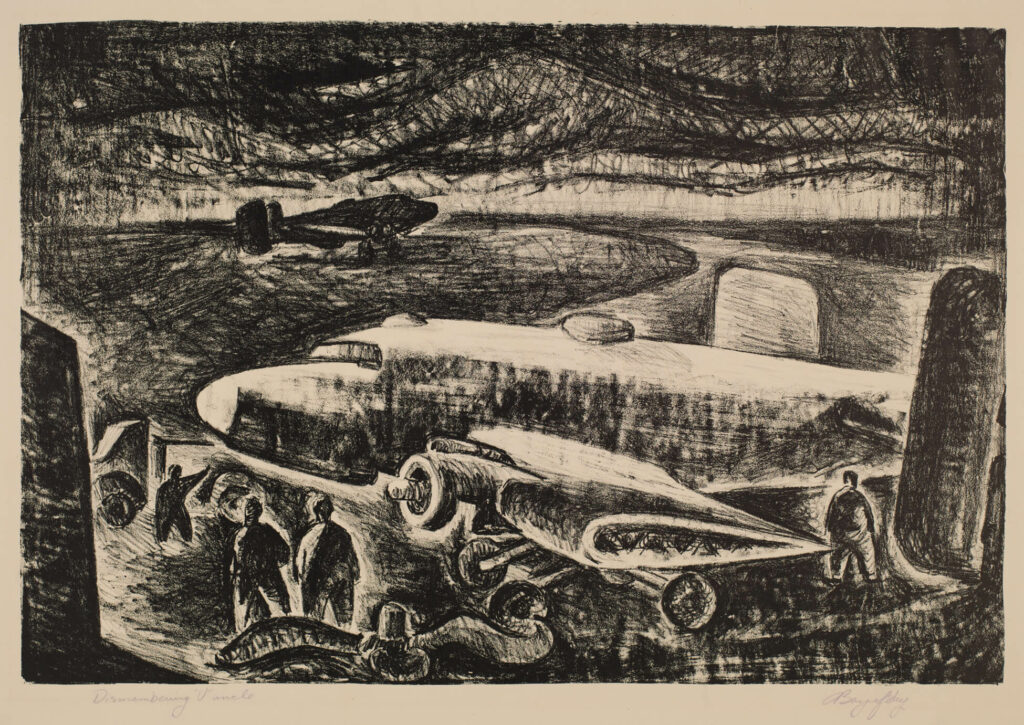
Quant à l’art de guerre non officiel, il se développe notamment pendant les périodes sans activité, et parfois longues, des soldats, lesquels se voient encouragés à peindre et à exposer dans le but de favoriser l’esprit d’équipe et de dissiper l’ennui. On inaugure la première exposition d’art des Forces armées canadiennes à Toronto en 1942; celle-ci sera ensuite présentée dans huit camps militaires. Une seconde exposition a lieu en 1944 et une dernière, en 1945. L’œuvre de Beulah Jaenicke Rosen (1918-2018), du Service féminin de l’Armée canadienne, Eat Early in Comfort (Manger tôt en tout confort), 1943, montrant une scène animée dans un restaurant d’Ottawa, figure à l’exposition de 1944. Rosen compte parmi les cinq femmes sur un total de trente-trois artistes. Avant d’être officiellement mandatée, Molly Lamb Bobak peint la foule de la soirée d’ouverture de l’exposition composée de militaires en uniforme et de civils bien habillés dans Opening Night of the Canadian Army Art Exhibition (Soirée d’ouverture de l’exposition d’art de l’Armée canadienne), 1944. L’Aviation royale canadienne (ARC) organise également des expositions. L’artiste Tom Hodgson (1924-2006), futur membre fondateur du Groupe des Onze, présente First Flight (Premier vol), 1944, dans le cadre de l’exposition de l’ARC tenue au Musée des beaux-arts du Canada qu’il voit partir en tournée plus tard la même année. Enfin, le designer textile et artiste-soldat George Broomfield (1906-1992) diffuse son art de guerre par l’entremise de la Ontario Society of Artists, en participant aux expositions annuelles de 1943 et 1944 de la société.


Une fois la guerre terminée, la plupart des artistes-soldats ayant exposé pendant le conflit ne jouissent pas d’une reconnaissance immédiate de leur contribution artistique, contrairement aux participants du programme de la Collection d’œuvres canadiennes commémoratives de la guerre. Broomfield offre ses aquarelles au MBAC, qui les accepte finalement juste avant le transfert de toutes les œuvres d’art de guerre au Musée canadien de la guerre en 1971. Cette dernière institution fera l’acquisition des œuvres d’art de guerre de Hodgson seulement en 1997 et celles de Rosen, encore plus tardivement, soit en 2006. Certains artistes ne parviennent à peindre leurs expériences de guerre que de nombreuses années plus tard, ce qui repousse évidemment la date de leur acquisition institutionnelle. Ainsi, au terme d’une thérapie par l’art offerte à sa résidence pour aînés, Richard Coady (né en 1921) peint seulement en 1992 certains souvenirs de guerre difficiles, notamment D-Day Landing, Normandy (Le débarquement du jour J, Normandie), tableau acquis ensuite par le Musée canadien de la guerre.
Les femmes artistes civiles contribuent à documenter la guerre sur le front intérieur lorsque le MBAC commande des œuvres à plusieurs d’entre elles en 1944 et 1945. À l’époque, le directeur H. O. McCurry déplore l’absence d’œuvres picturales portant sur le travail des femmes militaires canadiennes au Canada. Ainsi, Paraskeva Clark (1898-1986), Alma Duncan (1917-2004), Bobs Coghill Haworth (1900-1988) et Pegi Nicol MacLeod (1904-1949) pallieront ensemble le manque et produiront des tableaux importants.

En 1944 et 1945, grâce à deux commandes importantes, Nicol MacLeod réalise près d’une centaine de compositions à l’aquarelle et à l’huile consacrées aux femmes et à la guerre. Des œuvres audacieuses et colorées comme Morning Parade (Parade matinale), 1944, célèbrent les 17 000 femmes de l’Aviation royale canadienne (Division féminine), les 21 600 du Service féminin de l’Armée canadienne et les 7 000 de la Marine royale canadienne. Conçues dans un style différent de celui de la plupart de ses contemporaines, les œuvres de Nicol MacLeod représentent souvent des femmes militaires canadiennes nettoyant, cuisinant, lavant la vaisselle, participant à des exercices ou défilant dans des parades.
Les néo-Canadiens produisent eux aussi des œuvres à partir de leur expérience de la guerre, mais nombreuses sont celles qui ont sombré dans l’oubli. Quelques-unes, néanmoins, se démarquent – des succès en grande partie attribués à la détermination personnelle des artistes ou au sujet choisi. Parmi ces œuvres, on trouve le dessin War Torn (Déchiré par la guerre), 1943, du concepteur d’affiches de l’ONF d’origine allemande Fritz Brandtner – une image puissante mais fictive d’un violent bombardement, qui traduit une idéologie antiguerre. Formé à la manière expressionniste et cubiste, Brandtner immigre au Canada après la Première Guerre mondiale.
Au cours des vingt années qui séparent les deux guerres mondiales, des changements substantiels se produisent dans le monde des arts graphiques. La photographie, par exemple, réduit considérablement la nécessité de recourir à des illustrateurs et illustratrices, dont le travail diminue au fur et à mesure pendant et après le conflit. Le journal de guerre illustré de Molly Lamb Bobak, W110278: The Personal War Records of Private Lamb, M., documente la vie de l’artiste dans l’Armée canadienne entre 1942 et 1945. L’objet demeurera peu connu jusqu’à sa publication intégrale en 1992. La première page, « Girl Takes Drastic Step! (Une jeune femme prend une décision radicale!) », 1942, montre la jeune recrue en uniforme sous la pluie, une scène dans laquelle on pourrait voir un indice de son ambivalence initiale à s’enrôler.
Une fois le conflit terminé, les expériences de William Allister (1919-2008) en tant que prisonnier de guerre attirent l’attention grâce à la volonté de ce dernier de partager son vécu, notamment dans le documentaire canadien de 1995 intitulé The Art of Compassion. Emprisonné par les Japonais après la bataille de Hong Kong en 1941, il réussit à dérober suffisamment de matériel à ses ravisseurs pour tenir un carnet de croquis et un journal intime, et pour réaliser des peintures, dont la plupart disparaîtront. L’un des dessins qui subsiste, I’m ’A Comin’ Home! (Je rentre à la maison!), v.1945, exprime la joie d’Allister à l’idée de sa libération. Il représente un soldat arborant un large sourire, maniant les rames d’une petite jonque (un bateau à voile traditionnel chinois).


En revanche, c’est pendant la guerre que les caricaturistes bâtissent leur réputation. Au sommet d’un petit groupe de ces professionnels canadiens – dans lequel figure entre autres le dessinateur Les Callan (1905-1986) du Toronto Star –, on trouve l’artiste et ancien soldat Bing Coughlin (1905-1991). À l’époque, le journal des soldats, The Maple Leaf, publie les épreuves et les tribulations du personnage de Coughlin, « Herbie », comme en témoigne I don’t give a damn what the Maple Leaf says (Je me fiche de ce que dit le Maple Leaf), 1944. Un autre caricaturiste occasionnel du Maple Leaf, le soldat Thomas Luzny (1924-1997), est devenu muraliste après la guerre, mais son passé de caricaturiste demeure manifeste. Humanity in the Beginning of the Atomic Era (L’humanité au début de l’ère atomique), 1953, où une terrifiante tête de mort blanche émerge d’une explosion nucléaire, nous parle des futures tragédies que l’artiste imagine succéder au conflit.

Pendant le conflit, les reproductions d’œuvres revêtent également une importance nouvelle dans la vie des artistes. H. O. McCurry répond à la suggestion de A. Y. Jackson, qui souhaite que le MBAC appuie la reproduction d’œuvres d’artistes canadiens afin que les répliques soient distribuées dans les bases des forces armées au Canada et outre-mer. Les deux hommes croient qu’une telle entreprise permettrait de rémunérer les artistes à faible revenu n’ayant pas obtenu le titre d’artiste de guerre officiel. La distribution prend des proportions impressionnantes : 1 781 tirages à la Marine royale canadienne, 3 000 à l’Armée canadienne, 3 000 à l’Aviation royale canadienne et 2 727 aux services auxiliaires. Halifax Harbour [North and Barrington Streets] (Le port d’Halifax [Les rues North et Barrington]), v.1944, de Leonard Brooks (1911-2011), époux de la célèbre photographe canadienne Reva Brooks (1913-2004), constitue la seule pièce qui s’éloigne de l’imagerie généralement bucolique de la série portée sur le temps de paix. Notons néanmoins que, dans ce cas-ci, Brooks travaillait comme artiste officiel attaché à la marine.
Durant cette période, le travail des photographes civils renforce le précédent établi lors de la Première Guerre mondiale; ainsi abondent les articles de journaux et de magazines aux pages saturées de photographies qui répondent aux besoins du public et de la propagande. Wait for Me, Daddy (Attends-moi papa), une image capturée par l’Américain Claude Dettloff (1899-1978) le 1er octobre 1940, s’inscrit parmi les premières photographies civiles mémorables de la guerre – on y voit le Régiment de la Colombie-Britannique défilant dans une rue de New Westminster. Alors que Dettloff s’apprête à prendre la photo pour un journal local, le jeune Warren échappe à la surveillance de sa mère et se rue vers son père, le soldat Jack Bernard, qui participe au défilé. La photo connaît une large diffusion : on l’utilise en particulier dans le cadre de campagnes encourageant la population canadienne à acheter des obligations de guerre pour financer le conflit. Le public de l’époque voyait en cette image le reflet des valeurs familiales, l’importance de l’enrôlement et la nécessité de mener la guerre afin de préserver les familles.

Le Turco-Canadien Malak Karsh (1915-2001) (frère de Yousef Karsh [1908-2002]) compte parmi les photographes civils les plus connus. Au début de 1946, l’inauguration de l’exposition d’art de guerre canadien au Musée des beaux-arts du Canada est sur le point de se dérouler, et les autorités engagent le jeune Karsh pour photographier plusieurs des artistes de guerre officiels au milieu de leurs peintures et de leurs croquis. Les images des tableaux eux-mêmes ne répondent manifestement pas aux standards de l’industrie publicitaire. La photographie de Karsh montrant Alex Colville peignant Infantry, Near Nijmegen, Holland (Fantassins près de Nimègue, Hollande), 1946, entouré d’esquisses, exclut le recours personnel du peintre à la photographie. Or, semble-t-il que l’inspiration de Colville pour ce tableau ne viendrait pas tant de ses esquisses, mais plutôt d’une photographie de la Seconde Guerre mondiale distribuée par les Britanniques.


Malgré les promesses de développement de la sculpture canadienne après la Première Guerre mondiale, le bilan sculptural des années 1939 à 1945 est mince en raison de l’absence d’œuvres commémoratives. De ces années, Freedom from Want (Vivre à l’abri du besoin), 1944, de Violet Gillett (1898-1996), une représentation émouvante d’une femme berçant son enfant endormi – manifestement inspirée du discours du président Franklin D. Roosevelt sur la situation de l’Union de 1941 et les quatre libertés fondamentales que défendent les États-Unis en prenant part au conflit – ne sera jamais coulée. De même, c’est l’amitié personnelle qui pousse Florence Wyle à produire un bas-relief en bronze de l’artiste officiel de guerre Charles Comfort en uniforme, alors que ce dernier profite d’un congé chez lui au début de 1945. Quant à sa compagne et collègue sculptrice Frances Loring, elle se contente d’écrire, et constitue une petite publication non datée destinée aux soldats qui disposent de temps libre : How to Get Started in Woodcarving for Pleasure.
Comme lors de la Première Guerre mondiale, les soldats et les civils ont à nouveau produit des quantités de ce que l’on appelle l’art des tranchées, des souvenirs fabriqués principalement à titre de souvenirs personnels à partir de déchets généralement métalliques du champ de bataille. Après sa démobilisation en 1945, le sculpteur Joe Rosenthal (1921-2018) transforme une crosse de fusil en bois en une sculpture figurative sans titre. Incarcéré en tant que prisonnier de guerre au camp Sham Shui Po, dans la partie de Hong Kong occupée par les Japonais, le civil canadien R. P. Dunlop (dates inconnues) sculpte un certain nombre d’objets dans du bambou local, notamment une pipe décorée d’une feuille d’érable. Le Nose Art, surtout caractérisé par des dessins humoristiques peints sur les avions, constitue peut-être la forme la plus reconnaissable d’art des tranchées à se révéler pleinement pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi ces œuvres, on compte Fangs of Fire (Crocs de feu), 1944-1945, de Floyd Rutledge (1922-2006).


Souvenir de l’Holocauste
Durant la Seconde Guerre mondiale, peu d’artistes officiels ont conscience de l’Holocauste (lorsque l’Allemagne nazie et ses collaborateurs orchestrent le massacre de six millions de Juifs et de millions d’autres personnes) qui se déroule autour d’eux en Europe, et ceux ayant accès aux camps de la mort à leur libération sont encore moins nombreux. En 1945, Aba Bayefsky, un artiste de guerre officiel juif âgé de vingt-deux ans rattaché à l’Aviation royale du Canada, représente le camp de concentration nazi de Bergen-Belsen. Deux autres artistes de guerre officiels, Alex Colville et Donald Anderson (1920-2009), visiteront ce même camp de concentration allemand peu après sa libération par les Britanniques. Bodies in a Grave, Belsen (Corps dans une fosse, Belsen), l’œuvre élégiaque de Colville, deviendra l’image la plus connue de ce lieu tragique.


L’Holocauste occupe une place importante au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et ce, malgré le peu de visibilité que lui avait conféré l’art officiel pendant le conflit. Une fois la guerre terminée, les informations sur le nombre effroyable et sans précédent d’exterminations se répandent progressivement dans la sphère publique, et les artistes, juifs et non juifs, soldats et civils, réagissent aux images tragiques du génocide qui paraissent dans les films et les photographies. À cette époque, Jack Shadbolt (1909-1998), en service à Londres, est chargé de trier les photos prises dans les camps de concentration nazis de Bergen-Belsen et Buchenwald par les membres du Corps royal canadien des transmissions. Pour exprimer l’horreur qu’il a vécue en exécutant cette tâche, il entreprend une série d’œuvres en 1946, après son retour au Canada. Des pièces telles que Dog Among the Ruins (Chien parmi les ruines), 1947, où l’on voit un chien en gros plan hurlant à la mort au milieu des ruines laissées par les bombardements, témoignent visuellement de la profonde colère qui l’animait devant l’horrible héritage de la guerre.
Autre artiste notable de la période succédant immédiatement à la Seconde Guerre mondiale, Gershon Iskowitz (1920/21-1988) arrive au Canada en 1949, après avoir survécu aux camps de concentration allemands d’Auschwitz et de Buchenwald. Il dessine l’horreur des camps avec des matériaux qu’il recueille en cachette. Condemned (Condamné), v.1944-1946, portrait d’un homme au destin funeste – à en juger par l’ombre noire se profilant derrière sa tête – offre un exemple émouvant de son travail. Iskowitz mènera ensuite une brillante carrière artistique au Canada.
Les œuvres d’après-guerre d’Aba Bayefsky sur l’Holocauste apparaissent beaucoup plus tard, mais elles attestent des profondes cicatrices que ce terrible massacre aura laissées à l’artiste officiel. Sa composition monochrome Remembering the Holocaust (Souvenir de l’Holocauste), 1988, par exemple, montre la Grande Faucheuse debout parmi les corps mutilés qu’elle récolte, tandis que les noms des principaux camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale bordent l’image. Des formes rappelant des flammes s’élèvent derrière la créature meurtrière, et contribuent à la frénésie hystérique à glacer le sang qui se dégage de la composition.
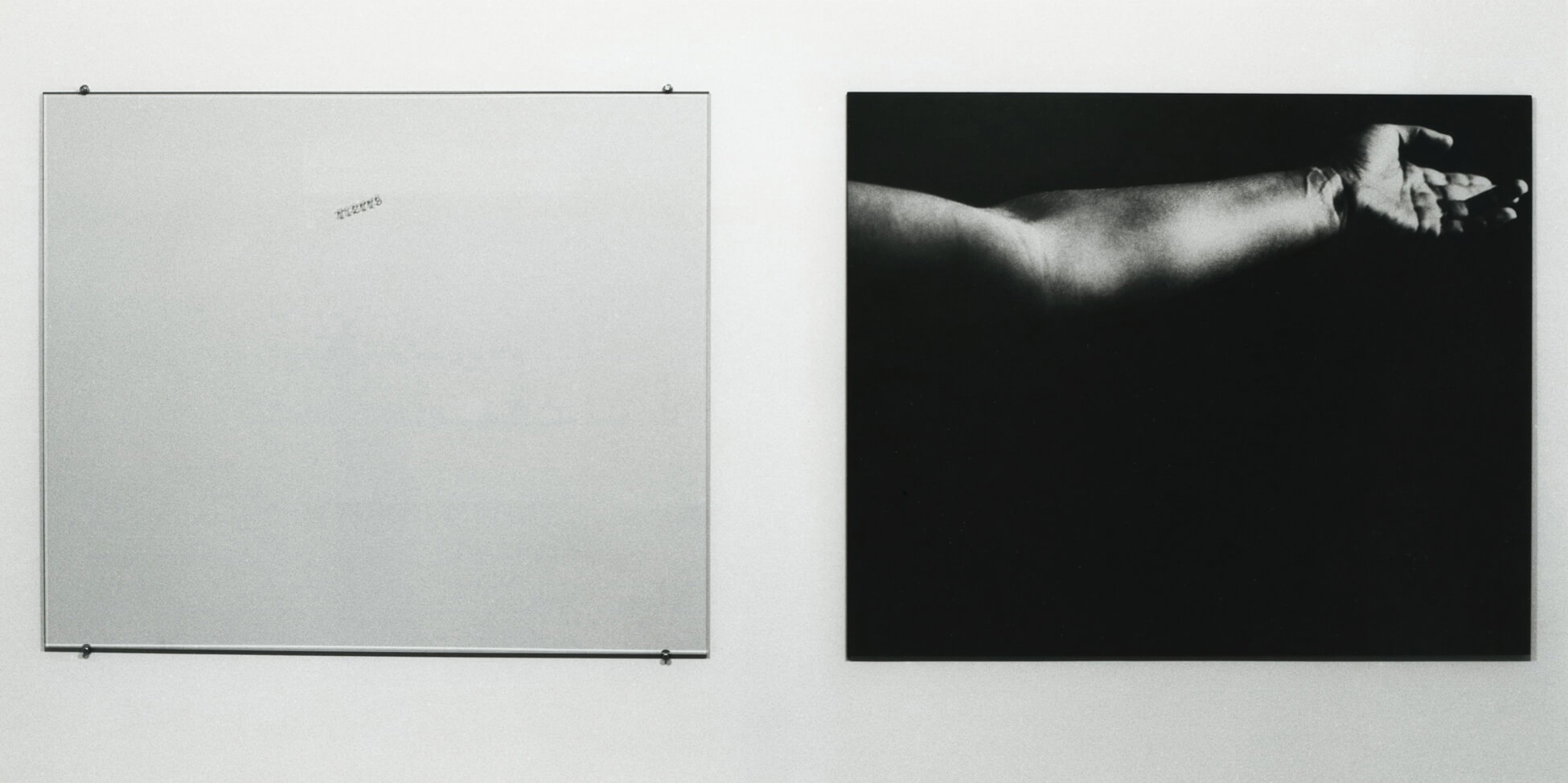
L’élégiaque diptyque en noir et blanc Of a Place, Solitary Of a Sound, Mute (D’un lieu, solitaire D’un son, muet), 1989, de Barbara Steinman (née en 1950), témoigne des réflexions de l’artiste sur les leçons durables de l’Holocauste, qu’elle-même n’a pas vécu. Elle met également en évidence l’héritage amer du génocide, qui affecte non seulement les personnes qui en ont été témoins, mais également celles des générations qui suivent. Dans cette œuvre de Steinman, la photographie de gauche montre la peau d’une personne en gros plan; sur la surface de verre recouvrant l’image est gravé un nombre à six chiffres, lisible de biais uniquement, soit quand le spectateur se tient devant la photographie de droite, dans laquelle un bras gauche nu étendu rappelle le bras du Christ crucifié. L’ensemble évoque le tatouage des prisonniers d’Auschwitz.
Aujourd’hui, le Monument national de l’Holocauste à Ottawa, inauguré en 2017 et intitulé Un paysage de deuil, de souvenirs et de survie, constitue le plus récent mémorial national du Canada. La structure, conçue par l’architecte américain d’origine polonaise spécialiste de musées juifs Daniel Libeskind (né en 1946) et par l’architecte paysagiste Claude Cormier (né en 1960), représente une étoile de David aux pointes formées de six segments triangulaires. Sur les murs du monument figure l’œuvre d’Edward Burtynsky (né en 1955), notamment six photographies qu’il a prises parmi plus de deux cent cinquante images saisies lors de ses visites de nombreux sites reliés à l’Holocauste partout en Europe.


La guerre froide
Comparée à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, qui se sont échelonnées sur quatre et six ans respectivement, la guerre froide se déroule de 1945 à 1989, soit plus de quatre décennies, et englobe ainsi un certain nombre de conflits. Ces années sombres sont marquées par de fortes tensions géopolitiques entre les États-Unis capitalistes et leurs alliés occidentaux, d’une part, et l’Union soviétique communiste et le bloc de l’Est, d’autre part. La menace de l’anéantissement nucléaire plane nuit et jour alors que les deux camps développent leurs armes atomiques. Le caricaturiste John Collins (1917-2007) de la Montreal Gazette intitule l’une de ses caricatures éditoriales de 1945 How Do We Put the Genie Back in the Bottle? (Comment remettre le génie dans la bouteille?) – le dessin montre un grand génie sortant d’une petite bouteille étiquetée « énergie nucléaire ». Dans sa sculpture des Territoires du Nord-Ouest, Emanuel Hahn représente une figure tenant de l’uranium rayonnant d’énergie, faisant ainsi allusion aux riches ressources nucléaires du Canada. Des guerres non concluantes se déroulent en Corée, de 1950 à 1953, et, de façon plus significative, au Vietnam, de 1955 à 1975. Le Canada combat en Corée mais pas au Vietnam. La guerre froide prend fin avec le démantèlement du mur de Berlin en 1989, qui permet la réunification de l’Allemagne de l’Est et de l’Allemagne de l’Ouest.
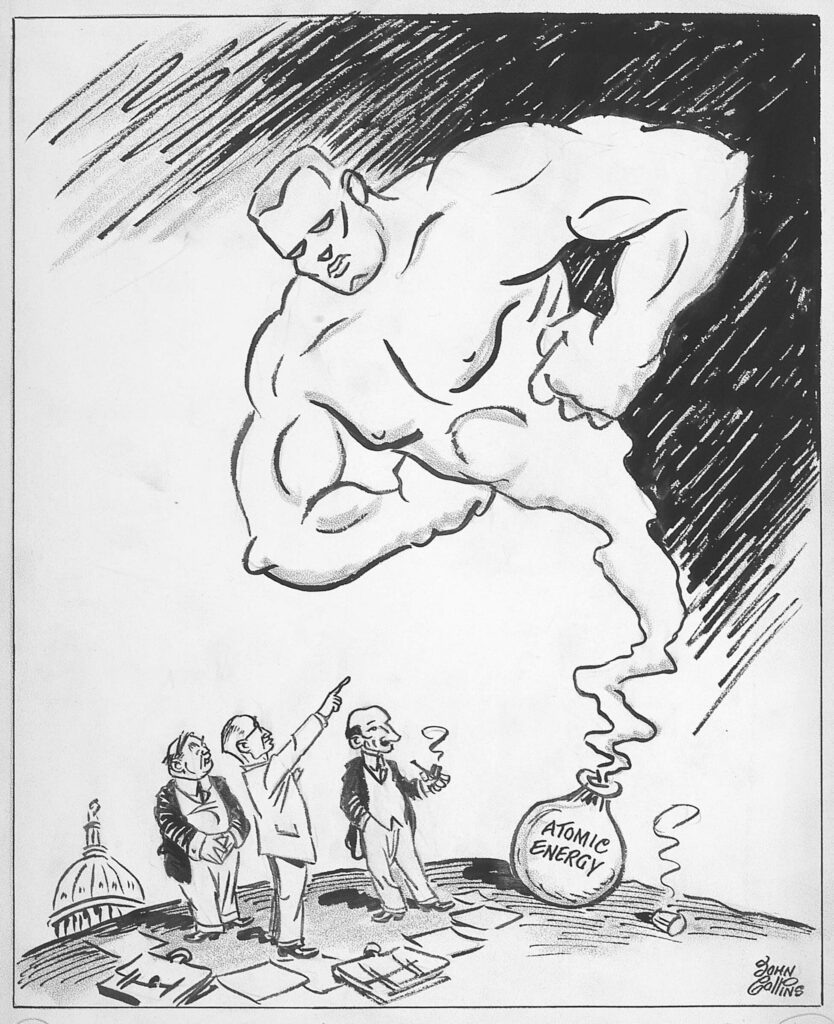

Sur le plan artistique, le choix des sujets et les modes de représentation reflètent inévitablement la violence et les défis des grands changements et conflits géopolitiques, bien que le phénomène au Canada prenne des proportions moins spectaculaires qu’aux États-Unis. Cela s’explique en partie par le fait que le Canada de l’époque se considérait davantage comme un artisan de la paix mondiale plutôt que comme une force militaire, et ce, même si l’État entretenait une armée active. Le premier ministre canadien, Lester B. Pearson, reçoit le prix Nobel de la paix en 1957 pour le soutien efficace apporté à la création des forces de maintien de la paix des Nations Unies, lesquelles avaient permis de rétablir la paix en Égypte pendant la crise de Suez en 1956. Par conséquent, l’art de guerre de cette période tend à documenter l’activité militaire en tant qu’occupation de maintien de la paix ou de protestation en faveur de la paix. En outre, pour la première fois, l’art officiel ne prime pas en termes de réputation artistique.
Du point de vue des Forces canadiennes, la photographie, employée comme outil documentaire, devient le moyen d’expression le plus important. Un exemple fascinant d’une photographie de la guerre de Corée – conflit opposant la Corée du Nord (soutenue par la Chine) et la Corée du Sud (soutenue par les alliés occidentaux, dont le Canada) – montre le futur premier ministre du Québec René Lévesque, alors correspondant de guerre pour le service international de Radio-Canada, traversant à gué un petit ruisseau, les bras levés, maintenant son magnétophone en équilibre sur sa tête. Cette photographie, parmi tant d’autres, montre à quel point le conflit s’est immiscé dans la société canadienne : autrement dit, l’image traduit l’impact de la guerre froide sur la vie des principales personnalités politiques, sur le cours de l’histoire ainsi que sur la culture visuelle du pays. Des dizaines d’images ont enregistré les actions des troupes canadiennes en Corée, aussi variées que de sillonner le pays à la marche ou de combattre au lance-flammes.


La création d’une collection d’œuvres d’art de guerre officielles demeurait un objectif ambitieux. En janvier 1954, au début de la guerre froide, en l’absence d’un programme d’art officiel, l’Aviation royale canadienne charge Robert Hyndman (1915-2009) – ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, pilote de Spitfire et artiste de guerre officiel – de peindre les activités militaires dans les bases aériennes canadiennes en France et en Allemagne de l’Ouest. En théorie, Married Quarters under Construction at 4 Wing, Baden (Logements familiaux en construction à la 4e Escadre, Baden), 1954, montre les logements de la base aérienne de Baden-Soellingen, en Allemagne de l’Ouest, vieille d’un an, l’une des nombreuses bases alliées établies pour assurer la paix après la guerre. Mais, en réalité, le spectateur a plutôt affaire à un paysage traditionnel où figurent une rivière ou une route, des champs verts fertiles, un ruban de forêt verte et de lointains sommets montagneux gris-bleu. Rien n’indique la présence militaire, ce qui, aux yeux de certains, enlève au tableau sa valeur d’art de guerre. Néanmoins, la représentation de grues de construction rappelle l’occupation du territoire allemand par les Alliés, un fait qui, neuf ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, suscite toujours le malaise.

En 1968, le Programme d’aide des Forces canadiennes aux artistes civils (PAFCAC), 1968-1995, rétablit l’art militaire officiel au Canada. Beaucoup d’artistes du PAFCAC ont déjà une expérience militaire, tout comme leurs prédécesseurs des deux programmes officiels précédents. Les œuvres d’art du PAFCAC ne sont pas nombreuses et elles s’orientent fortement vers l’illustration. Colin Williams (né en 1935), par exemple, peint à Chypre, où le Canada contribue à maintenir la paix entre les populations grecque et turque de l’île. Sa représentation détaillée d’un transport de troupes blindé (TTB), Canadian A.P.C. Patrol – Old City, Nicosia, 1974 (Patrouille d’un TTB canadien – Vieille ville, Nicosie, 1974), 1975, s’appuie davantage sur des références photographiques que sur un travail d’observation directe. La guerre de Corée inspire Edward Zuber (1932-2018) qui y participe à titre de soldat. En 1978, motivé par le 25e anniversaire de la fin de la guerre de Corée et par l’absence de tout programme d’art officiel canadien s’y rapportant, le soldat commence à peindre quinze toiles tirées de ses souvenirs personnels – Freeze (Figer) en est une déclinaison – dont il vend avec succès les reproductions. Cette série fait sa réputation et lui vaut sa nomination à titre d’artiste du PAFCAC pendant la première guerre du Golfe de 1991 – la campagne militaire menée par les États-Unis au Moyen-Orient pour repousser l’invasion du Koweït par l’Irak.


L’art de l’affiche militaire disparaît largement de la scène artistique à cette époque, mais on l’utilise encore au sein des forces, où il sert à resserrer les règles et les règlements. La sculpture demeure également dans l’ombre à cette période; l’absence de nouveaux monuments de guerre anéantit toute possibilité de projets en ce domaine. Ce n’est qu’en 1982 qu’on inaugure une seconde fois le Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa pour y inclure les dates de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, et de la guerre de Corée, 1950-1953.
L’art contestataire révèle une facette particulièrement importante des années de la guerre froide. Pour la plupart, ces œuvres traduisent une vision subjective des événements plutôt qu’elles en dressent un portrait représentatif, comme l’illustre le Cénotaphe de Chicoutimi, 1958, du sculpteur Armand Vaillancourt (né en 1929). D’une hauteur de cinq mètres, ce curieux monument commémoratif de la Seconde Guerre mondiale, dont la forme évoque celle d’un gros canon, paraît paradoxalement dénoncer la guerre. « Je n’allais pas faire un de ces trucs où un soldat en poignarde un autre », déclarera-t-il. L’écheveau métallique abstrait L’Humain, 1963, installé à Val-des-Sources (anciennement Asbestos), au Québec, constitue la réponse de Vaillancourt à la crise des missiles de Cuba de 1963, qui a failli entraîner les États-Unis et l’Union soviétique dans une guerre. Le site Web de l’artiste indique que la sculpture aurait provoqué un scandale.


À l’échelle mondiale, durant cette période, la contestation politique vise surtout la guerre du Vietnam, de 1955 à 1975, mais au Canada, le mouvement aura un impact mineur : émergent néanmoins des affiches comme He Won’t Be There. Be Sure You March Oct. 26 Against the War in Vietnam (Il ne sera pas là. Ne manquez pas de manifester le 26 octobre contre la guerre au Vietnam), 1968, sur laquelle figure un portrait de Pierre Elliott Trudeau. Par ailleurs, Joyce Wieland (1931-1998), établie alors à New York, se tourne vers le cinéma pour dénoncer la guerre. Rat Life and Diet in North America, 1968, est une satire du conflit mettant en scène des gerbilles, auxquelles les rats du titre font référence, et leur geôlier, un chat. Les gerbilles rencontrent un certain nombre d’obstacles alors qu’elles tentent de fuir les États-Unis pour se réfugier au Canada, pays bienveillant et riche en nourriture.
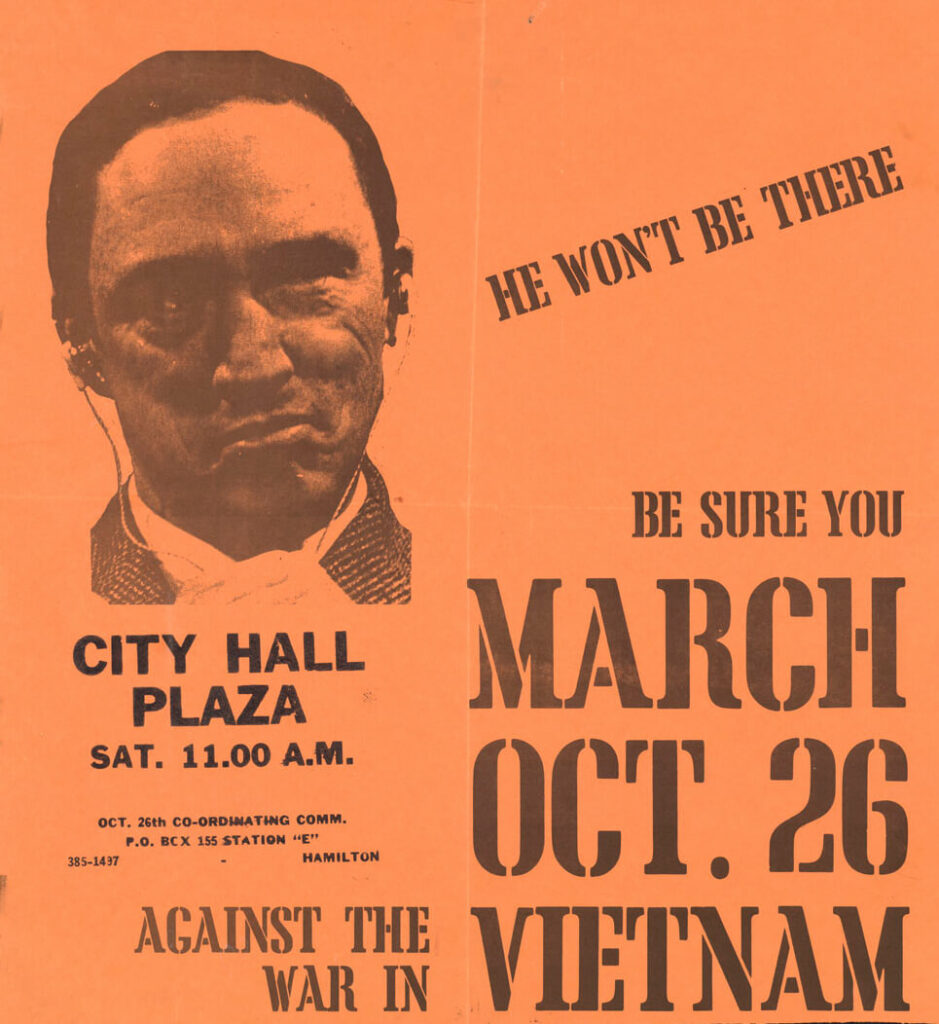

La murale de Greg Curnoe (1936-1992), Homage to the R 34 [The Dorval Mural] (Hommage au R 34 [Peinture murale de l’aéroport de Dorval]), 1967-1968, se distingue également parmi les œuvres qui dénoncent la guerre. Réalisée pour l’aéroport international de Montréal (aujourd’hui l’Aéroport international Montréal-Trudeau), à Dorval, au Québec, où elle ne reste accrochée que huit jours avant d’être entreposée, la pièce monumentale de trente-deux mètres de long se compose de vingt-six panneaux de couleurs vives et lumineuses représentant les voisins et amis de Curnoe ainsi qu’un ensemble de personnages historiques canadiens à bord des nacelles du premier dirigeable à traverser l’Atlantique en 1919 – innovation technologique que la murale commémore. Pour Curnoe, cependant, l’œuvre véhicule une idéologie pacifiste, tel un manifeste : elle contient d’ailleurs des allusions au coût humain de la guerre, notamment le bombardement d’une école de Londres pendant la Première Guerre mondiale. La figure qui chute de la seconde nacelle, la main sectionnée par l’hélice tourbillonnante et d’où le sang gicle – une évocation de la guerre du Vietnam –, suscite spécialement la controverse. Les autorités notent une ressemblance avec le président américain de l’époque, Lyndon B. Johnson, critiqué pour son rôle dans l’escalade de la participation américaine au Vietnam, ce à quoi Curnoe répond simplement qu’en réalité, il ne s’agit pas du président, mais d’un ami personnel. L’œuvre, jugée offensante pour les voyageurs américains, ne sera guère exposée après son retrait.
-
Greg Curnoe, Homage to the R 34 [The Dorval Mural] (Hommage au R 34 [Peinture murale de l’aéroport de Dorval]), 1967-1968
Peinture émail à l’uréthane Bostik sur contreplaqué et acier, hélices d’avion, écrans de métal et moteurs électriques, 26 panneaux de dimensions irrégulières montés en trois sections : 295 x 1551 x 25,5 cm; 295 x 1109,9 x 25,5 cm; 191,5 x 492,7 x 2,5 cm (longueur totale 32,2 m)
Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa -
Greg Curnoe, Homage to the R 34 [The Dorval Mural] (Hommage au R 34 [Peinture murale de l’aéroport de Dorval]) (détail des panneaux 1-5), 1967-1968
Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa -
Greg Curnoe, Homage to the R 34 [The Dorval Mural] (Hommage au R 34 [Peinture murale de l’aéroport de Dorval]) (détail du panneau 8), 1967-1968
Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa -
Greg Curnoe, Homage to the R 34 [The Dorval Mural] (Hommage au R 34 [Peinture murale de l’aéroport de Dorval]) (détail des panneaux 14-18), 1967-1968
Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa -
Greg Curnoe, Homage to the R 34 [The Dorval Mural] (Hommage au R 34 [Peinture murale de l’aéroport de Dorval]) (détail des panneaux 18-22), 1967-1968
Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa
À travers ses puissants dessins produits dans les années 1980, tels que Second Strike (Deuxième frappe), 1981, John Scott (né en 1950) condamne les essais de missiles de croisière au Canada. On désigne par missiles de croisière des armes à système de guidage externe conçues pour couvrir d’énormes distances, permettant ainsi de lancer des bombes puissantes avec précision. La décision du gouvernement canadien en 1983 d’autoriser les missiles de croisière américains à voler dans l’espace aérien canadien engendre des répercussions politiques considérables.
L’œuvre poignante et viscérale de Geoff Butler (né en 1945), Happy Days Are Here Again (Les jours heureux sont de retour), 1983, montre un groupe de figures gravement brûlées formant une longue ligne serpentine à travers un désert nucléaire teinté de rouge sang. Au-dessus du groupe, un avion remorque une banderole portant l’inscription suivante : « Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons survécu à la guerre nucléaire ». L’imagerie ironique de Butler s’est avérée prémonitoire. Même si on a échappé au risque de l’anéantissement nucléaire en mettant fin à la guerre froide, le monde a dû affronter d’autres types de conflits qui ont entraîné des morts, des blessés et des horreurs auparavant inimaginables.

Après la guerre froide
Véritable calamité nationale, la crise d’Oka de 1990, qui a impliqué l’Armée canadienne, marque le premier conflit violent et médiatisé sur l’utilisation des terres entre les peuples autochtones et le gouvernement fédéral à la fin du vingtième siècle. Le litige porte sur une parcelle de terre sacrée située sur le territoire contesté de Kanienʼkehá:ka dans la réserve de Kanehsatake à Oka, au Québec, que certains voulaient transformer en terrain de golf. Le différend perdure, et la situation s’envenime, provoquant alors un affrontement armé qui oppose les manifestants à la Sûreté du Québec puis, plus tard, à l’Armée canadienne. La photographe indépendante Shaney Komulainen (née en 1963) saisit l’esprit guerrier du conflit dans son image du soldat canadien Patrick Cloutier et du manifestant ojibwé de la Saskatchewan Brad « Freddy Krueger » Larocque, face à face dans un moment de vive tension en septembre 1990.


Parmi les nombreuses œuvres d’art autochtones qui contestent le pouvoir de l’autorité gouvernementale dans ce conflit, citons Kanehsatake, 1990-1993, de l’artiste Saulteaux Robert Houle (né en 1947). Le tableau exprime l’impasse – état qui résume à lui seul la crise d’Oka –, mais de manière abstraite cette fois : le rectangle vertical dans lequel est gravé le mot Kanehsatake rencontre le rectangle bleu, fort contrastant, qui représente la police et l’armée. Pendant les 78 jours que dure la crise, la réalisatrice abénaquise Alanis Obomsawin (née en 1932), derrière les barricades, filme de l’intérieur les altercations parfois violentes. Il en résulte un documentaire, Kanehsatake: 270 Years of Resistance, 1993, qui remporte de nombreux prix internationaux. Elle définit le mot « résistance » de son titre comme renvoyant à l’époque du roi français Louis XIV, qui a donné les terres des Kanienʼkehá:ka à un ordre religieux catholique, et ce, sans l’accord de ces derniers.

Sur le plan international, la fin de la guerre froide est marquée par l’instabilité et la fragmentation mondiales. Dans ce contexte, le Canada assume plusieurs rôles axés sur le rétablissement et la consolidation de la paix à l’étranger entre 1990 et 2000. Le pays participe à la première guerre du Golfe en 1991 et emploie un seul artiste de guerre officiel, le spécialiste de la guerre de Corée Edward Zuber. Offrant un bon aperçu de sa production picturale de l’époque, Long Day at Doha (Une longue journée à Doha), 1991, présente deux soldats dans un poste de mitrailleuses vraisemblablement isolé dans le désert. En Somalie, en 1993, le Canada prend part à l’opération Délivrance, une tentative infructueuse de ramener la paix dans ce pays en proie à la guerre civile.
En Europe, de violents troubles civils résultant de divisions ethniques entraînent l’éclatement de nombreux pays anciennement communistes, et impliquent une fois de plus l’armée nationale. Pendant une décennie après 1991, par exemple, des unités des Forces canadiennes sont affectées à la mission des Nations Unies assurant le maintien de la paix en Croatie et ailleurs en ex-Yougoslavie. Les quelques œuvres d’art militaire que l’on retiendra de cette période ont en commun de s’éloigner d’une approche descriptive du sujet; les artistes préfèrent, de fait, un style moins réaliste orienté vers leur expérience subjective de certains événements vécus.
L’impact de l’art contestataire antérieur se reflète dans l’œuvre d’Allan Harding MacKay (né en 1944), l’un des derniers artistes du PAFCAC. Dans sa pièce Error (Erreur), 1993, parmi d’autres, il réagit intelligemment à ce qu’il a observé des opérations canadiennes de maintien de la paix en Somalie en 1993, pendant la guerre civile. En superposant et en obscurcissant son sujet photographié dans Erreur, l’artiste montre qu’étouffer la vérité peut paraître facile si cela évite à quelques-uns de devoir justifier publiquement une décision problématique – dans ce cas, la torture et le meurtre d’un jeune Somalien. Aussi ses œuvres remettent-elles en question le conservatisme général qui teinte la plupart des productions de ce programme artistique parrainé par le gouvernement. Plus tard, la quantité d’œuvres que Mackay crée en dehors du PAFCAC lui offre un autre moyen de composer avec son aversion personnelle pour les conflits. La destruction publique d’une grande partie de son œuvre non officielle sur la Somalie, en guise de protestation contre le bombardement du Kosovo en 1999, dans l’ex-Yougoslavie, témoigne de son dégoût, un acte qu’il répète en 2012 pour dénoncer ce qu’il considère comme un abus de pouvoir du gouvernement.


En 1995, le Princess Patricia’s Canadian Light Infantry engage trois artistes afin de documenter les activités de l’unité en Croatie, dont le peintre William MacDonnell (né en 1943), qui passe dix jours avec le régiment. Celui-ci n’hésite pas à reconnaître l’influence de l’artiste allemand Anselm Kiefer (né en 1945) sur son travail, lequel est inspiré en particulier des puissantes explorations de son prédécesseur sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, quand MacDonnell peint The Wall (Le mur) en 1995, il imite Kiefer en ajoutant des éléments emblématiques – sous la forme de noms d’anges – pour révéler des significations sous-jacentes, souvent personnelles, que les preuves visibles ne peuvent transmettre à elles seules.
La campagne contre le terrorisme

Une nouvelle ère de guerre débute en réponse aux attaques contre les États-Unis coordonnées par le groupe terroriste islamique Al-Qaïda le 11 septembre 2001 (9/11), qui ont entraîné trois mille morts et six mille blessés. Depuis lors, le monde lutte contre le terrorisme, que l’état anarchique de l’univers numérique facilite bien souvent. À l’époque, le Canada se révèle terriblement mal préparé, comme le montre la caricature d’Aislin dans la Montreal Gazette du 10 octobre 2001. Shoulder to Shoulder (Côte à côte) représente, non sans ironie, un avion militaire américain volant en compagnie d’une bernache du Canada : au lieu d’un casque, elle porte une casserole décorée d’une feuille d’érable, et une ceinture de munitions retenant une arme de poing lui enserre la poitrine.
En juin 2001, peu avant le 11 septembre, le ministère de la Défense nationale a lancé le Programme d’arts des Forces canadiennes (PAFC), quatrième programme officiel d’art de guerre au Canada, qui a grandement contribué à rétablir la primauté de l’art officiel. Quand le programme a débuté l’année suivante, la campagne contre le terrorisme de l’après-11 septembre avait été lancée, et les Forces canadiennes combattaient en Afghanistan. En date d’aujourd’hui, on compte plus de soixante-dix artistes du PAFC à avoir documenté les expériences des membres de l’Armée canadienne déployés au Canada et à l’étranger, et plus particulièrement en Afghanistan et dans les environs lorsque les circonstances le permettaient, ce qui n’a pas toujours été le cas. De plus en plus, l’accessibilité des théâtres de guerre se reflète dans l’art : la forme et le contenu des œuvres deviennent en quelque sorte l’expression des dangers accrus que les soldats et les civils rencontrent dans les zones de conflit.
Jusqu’en 2007, le PAFC sélectionne uniquement des artistes visuels, parmi lesquels certains ont un passé militaire. Une fois affectés, à l’instar de leurs prédécesseurs, beaucoup trouvent leurs sujets ou leurs inspirations dans la photographie et la vidéo pour la production d’œuvres souvent peintes. Au fil des années, les moyens d’expression employés par les artistes du PAFC se sont multipliés, mais la photographie demeure prépondérante. Contrairement aux programmes de la Première et de la Seconde Guerre mondiale et au Programme d’aide des Forces canadiennes aux artistes civils (PAFCAC), le PAFC n’exige pas des participants qu’ils fassent don de leurs œuvres à la collection nationale du Musée canadien de la guerre. Cette liberté se traduit par une indépendance créative et interprétative importante pour les artistes concernés. D’importantes possibilités d’exposition suivent, notamment à la Galerie des fondateurs des Musées militaires de Calgary.
Compte tenu du statut secondaire longtemps réservé à la photographie et de celui privilégié dont jouissait la peinture dans le domaine de l’art de guerre, on peut trouver un brin ironique le succès du photographe du PAFC Louie Palu (né en 1968), qui, dans le sillage du 11 septembre 2001, contribue à changer les mentalités. En 2006, alors qu’il travaille comme photographe pour le Globe and Mail de Toronto, Palu est envoyé à Kandahar, en Afghanistan, couvrir la mission de combat du Canada. Il retourne en Afghanistan à plusieurs reprises à titre de photographe indépendant avant que le Canada ne se retire de la mission en 2014.
En 2012-2013, les commissaires du Houston Museum of Fine Arts choisissent son œuvre pour figurer dans l’exposition War/Photography : Images of Armed Conflict and Its Aftermath (Guerre/Photographie : Images des conflits armés et de leurs conséquences). En 2014, Palu devient membre de l’Académie royale des arts du Canada, une institution dominée par la peinture et la sculpture pendant presque toute son existence. Quatre ans plus tard, le PAFC retient la candidature du photographe.

Le film arctique The Soniferous Æther of the Land Beyond the Land Beyond (L’éther sonifère des terres au-delà des terres au-delà), 2012, de Charles Stankievech (né en 1978), témoigne également de la nouvelle vision du PAFC. Malgré l’inspiration de l’artiste, soit une installation militaire du Grand Nord, il ne s’agit pas d’une œuvre descriptive. Le film révèle plutôt la frontière troublante entre le rôle de ce complexe militaro-industriel et la beauté pure de son site. De même, l’attention que requiert la machinerie de guerre dans l’œuvre du soldat et artiste Scott Waters (né en 1971) nichée dans les détails de chaque écrou et boulon séduit indubitablement. Cependant, Waters brise délibérément le charme, laissant des parties de ses œuvres vierges ou indistinctes et renforçant ainsi l’ambiguïté du sujet, lequel semble parfois revêtir une dimension autobiographique – on voit entre autres cet aspect du travail de Waters dans Ready State (Prêt), 2013.
Parallèlement à cette production artistique officielle, on trouve le travail d’artistes indépendants. Si les artistes canadiens connaissent bien les installations monumentales de Garry Neill Kennedy (1935–2021) dirigées contre l’infrastructure militaire américaine, la nature même de leur exécution – il les peint sur les murs de galeries entières – n’a visiblement pas eu grande influence sur leurs œuvres à ce jour. Fait néanmoins exception l’énorme murale anti-guerre au graphite Guantanamo, 2004-2005, de l’artiste de l’Île-du-Prince-Édouard Hilda Woolnough (1934-2007), de la prison éponyme, située dans la base militaire américaine à Cuba et où les détenus sont emprisonnés sans procès. De même, la peinture en trois parties What They Gave (Ce qu’ils ont donné), 2006, de Gertrude Kearns (née en 1950), nonobstant sa taille beaucoup plus petite, rend dans chacun des coups de pinceau expressifs le traumatisme provoqué par la rencontre de l’artiste avec la mort et le démembrement en Afghanistan.

Dans la plupart des sculptures canadiennes, le passé continue de s’imposer au présent. Non seulement bon nombre d’œuvres occultent la contribution des Autochtones à la guerre, mais elles ne parviennent souvent pas à s’émanciper des normes figuratives de l’art de guerre établies de longue date. Par exemple, les quatorze figures créées par Marlene Hilton Moore (née en 1944) et John McEwen (né en 1945), qui composent le Monument aux Valeureux, 2006, à Ottawa, et qui rendent hommage aux héros de guerre depuis les années 1600 à la Seconde Guerre mondiale, diffèrent peu de leurs prédécesseurs du dix-neuvième siècle. L’œuvre de Maskull Lasserre (né en 1978), cependant, déroge à la règle. Ses sculptures sur le thème du conflit armé, telles que Safe (Coffre-fort), 2013, réalisée à partir d’un véritable coffre-fort, amènent le spectateur à se questionner sur sa propre sécurité. L’artiste Sarah Beck (née en 1976) explore les mêmes idées dans le réservoir ÖDE, 2001, inspiré d’Ikea et présenté comme un objet essentiel pour toute famille moderne soucieuse de sécurité que l’on peut facilement assembler avec une clé Allen.
Miss Chief’s Wet Dream (Le rêve érotique de Miss Chief), 2018, de l’artiste cri Kent Monkman (né en 1965), une peinture d’histoire monumentale de 3,7 sur 7,3 mètres exécutée à la manière des grands maîtres, revisite l’histoire nationale d’un conflit millénaire déterminant mené entièrement en sol canadien. On reconnaît l’imagerie emblématique de Monkman dans le mélange de figures autochtones et européennes qui semblent se battre en mer, chacune à bord de leur embarcation – les Européens dans un radeau à gauche et les peuples autochtones dans un canot à droite. Chaque groupe symbolise une histoire passée et compte ainsi des personnages importants – la reine Victoria de Grande-Bretagne, par exemple. Des deux côtés gisent également des morts ou des mourants, et le doute plane quant à l’issue du combat. Avec ses protagonistes français, anglais et autochtones, le tableau semble s’inscrire dans une réflexion pessimiste tant sur la longue histoire du Canada jalonnée de conflits et d’actes de génocide culturel que sur ses conséquences actuelles. Pourtant, l’œuvre présente un curieux équilibre : personne ne gagne ou ne perd la lutte. En donnant un poids égal aux Européens et aux Autochtones, mais en laissant le dénouement du récit incertain, Monkman exploite singulièrement un thème tragique et fait naître une lueur d’espoir.


 À propos de l’auteure
À propos de l’auteure
 Autres livres d’art en ligne
Autres livres d’art en ligne
 Remerciements
Remerciements